LE
VATICAN, L’ARGENT
ET
LE POUVOIR
Frédéric
Harcourt
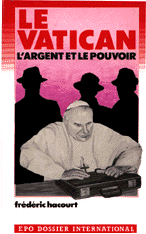
Mise
en page par Jean Leduc
|
Le Gouvernement de l'Église: |
|
|
|
L'Économie
du Saint-Siège: |
|
|

INTRODUCTION :
Derrière
les hauts murs qui enserrent le Vatican, se cache une puissance mondiale
financière et politique. Discrète. Coupée du monde extérieur. Connue
d'une poignée de personnes seulement. Parfois, une information filtre; le
plus souvent, quand quelque chose ne va pas : un scandale, comme celui de
la Banco Ambrosiano, les placements 'imprudents' du cardinal
Marcinkus... Frédéric Hacourt, journaliste à Rome, rompt le mur du
silence et nous emmène à travers les dédales du Vatican. A travers les
structures, l'organisation, vers le centre de décision véritable : là où
se cachent les finances.

Saint-Siège
et Vatican
A
Rome, le visiteur qui passe le Tibre serpentant au milieu de la ville et
emprunte l'avenue de la Conciliation, brèche rectiligne taillée par les
architectes du fascisme, débouche sur la place Saint-Pierre. Et devant la
majesté simple des deux demi-cercles de colonnades dessinées par Bernini
pour "tenir dans leurs bras la chrétienté entière", aussi
devant cette façade baroque de la basilique, oeuvre de Maderno, qui ne
parvient pas à éclipser l'harmonie de la coupoule projetée par Michel-Ange
ce visiteur sera sans doute pris par la sérénité, la magie des lieux.
Il se sentira - ce qui est la plus pure vérité transporté au coeur de
la religion, de la spiritualité. La proximité du Saint-Père lui donnera
la certitude de toucher le fond de la croyance. Il attendra une apparition
papale au grand balcon. Il priera, emporté par le mouvement (tout canalisé)
de la foule.

Ce
visiteur, ainsi mobilisé, sera loin de songer que derrière les façades
historiques, derrière les hauts murs qui entourent la Cité du Vatican,
se cache l'un des grands centres de pouvoir politique et économique
mondiaux, protégé par l'atmosphère feutrée de la cour des princes de
l'Eglise et par l'immunité qui découle de leur fonction. Un centre de
pouvoir qui n'a d'égal . si l'on envisage le secret qui l'environne, et
ses méandres - que le Kremlin en son temps.
Mais
ceci n'intéresse pas notre visiteur. Son pèlerinage aux sources de la
chrétienté lui aura peut-être coûté des années et des années
d'efforts autant psychologiques qu'économiques. Peu lui importe alors, de
savoir ce qui est fait de son offrande (laissée dans des troncs
judicieusement placés sur son parcours), car il est venu ici pour
chercher l'espoir et le salut. Et il les a trouvés grâce aux bons soins
d'un pape moderne, féru de relations publiques, d'effets théâtraux et
de grandes entreprises publicitaires.
Laissons
de côté la digne attitude du pèlerin parvenu à Rome. Analysons plutôt
le sens, la signification du trafic constant qui unit le monde de la
politique, le monde de la finance, et le palais de l'Eglise.
Tout
d'abord, une distinction banale en apparence mais essentielle dans ses
effets: celle qui sépare Etat du Vatican et Saint-Siège.
Le
Saint-Siège est cette souveraineté abstraite du pape sur les catholiques,
estimés à 700 millions. Un organisme, bien que ne possédant aucun
territoire, reconnu par toutes les instances internatiomiles. A l'échelle
planétaire, c'est la seule exception du genre - si l'on exclut l'Ordre de
Malte, par ailleurs directement lié au Siège Apostolique Autour (ce
concept de Saint-Siège, gravitent toutes les nuances de l'Eglise
universelle. Différent est (le la Cité du Vatican: ses quarante-quatre
hec -distraits- à la ville de Rome sont en fait ce qui subsiste des
territoires pontificaux qui, il y a un peu plus d'un siècle encore,
barraient l'Italie du Latium aux Marches. C'est un des plus petits états
du monde avec le Lichtenstein, la République de San-Marino et la
Principauté de Monaco. Il remplit les fonctions de support matériel aux
activités du Saint-Siège et de conservation de son patrimoine religieux,
artistique et culturel. Le pape en est le souverain de droit absolu et
divin, concentrant entre ses mains les trois pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire.
Le
point est de savoir lequel, du Saint-Siège et du Vatican, dépend (le
l'autre. Selon les paroles mêmes de Jean-Paul II, l'état existe comme
garantie de l'exercice de la liberté spirituelle du Siège Apostolique,
et donc comme moyen d'en assurer l'indépendance réelle et visible dans
son activité de gouvernement en faveur de l'Eglise universelle ( ... ).
Il ne possède pas une société propre au service de laquelle il aurait
été créé, et ne se base pas non plus sur les formes d'action sociale
qui déterminent couramment la structure et l'organe de tout autre Etat"
Plus prosaïquement, Pie XI le définissait comme "un petit lopin de
terre bien utile au Saint-Siège".
Faisons
un exemple concret : celui de la nationalité vaticane. Son octroi ne suit
aucune règle écrite, mais bien le bon vouloir des autorités compétentes
(les cardinaux) qui l'accordent en reconnaissance d'un lien spécifique
entre l'Etat et la personne (et cela concerne avant tout les diplomates,
les conseillers, les employés laïques résidents et leur famille). Les
citoyens du Vatican sont à cette heure plus ou moins quatre cents.
L'attribution
du passeport, par contre, est un privilège du SaintSiège. Car il faut
savoir que l'Etat souverain du Vatican n'entretient pas de relations extérieures.
Ces passeports sont actuellement au nombre de cent soixante, et en bénéficient
les ecclésiastiques diplomates.
Et
encore : le diocèse de Rome, sous la dépendance directe du pape, est
confié au Vicaire Général de Sa Sainteté (le Belge Petrus Canasius
Jean Van Lierde) et au Vicaire Général de Rome, archiprêtre de
Saint-Jean de Latran Nous avons compris ? Rien n'est moins sûr.
D'ailleurs, des générations et des générations de juristes italiens se
sont arraché et s'arrachent encore les cheveux pour tenter de délimiter
la souveraineté de l'État du Vatican et celle du Saint-Siège. Et sans
succès. Car si l'Etat, en vertu des règles internationales, détient
certaines franchises, le Saint-Siège, en vertu d'autres règles tout
aussi reconnues, bénéficie de facilités connexes qui en partie
recouvrent les premières. L'Etat du Vatican est un territoire, avec
citoyenneté mais avec diplomatie ; la citoyenneté ne donne pas droit au
passeport, et le passeport encore moins à la citoyenneté ; ce qui n'est
pas du ressort du Saint-Siège est du ressort de l'Etat, et vice-versa ;
un simple changement d'attribution peut déterminer, par exemple, un régime
fiscal différent. Le tout, dans le royaume de l'ambiguïté. Et nous
allons le voir, source d'une immense fortune pour le Saint-Siège (ou pour
le Vatican ?).
Ainsi,
le pape (l'Antichrist) résulte-t-il comme : Evêque de Rome ; Successeur du Prince des
apôtres Souverain Pontife de l'Eglise Universelle ; Patriarche d'Occident
Primat d'Italie ; Archevêque et Métropolite de la province romaine ;
Souverain de l'Etat de la Cité du Vatican ; et, enfin, Serviteur des
Serviteurs de Dieu. Le tout dûment enregistré par la Republique
Italienne et par bien d'autres Etats.
La
curie
Un
tel résultat ne surgit pas par hasard. L'image publique et internationale
du pape comme chef absolu de la spiritualité chrétienne, comme guide
unique et comme chef d'Etat, doit être confectionnée, transmise et
soutenue par une organisation politique solide. Ce qui sous-entend avant
tout une administration centrale hautement spécialisée et exclusive.
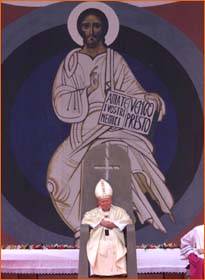
La
curie est cette administration, ce gouvernement de l'Eglise qui fonctionne
comme un instrument d'assistance du Saint Père dans ses multiples tâches.
En tant qu'organe suprême de l'Eglise la curie romaine agit suivant trois
lignes directrices; l'une, purement administrative, regarde la
subsistance de l'Etat du Vatican; la seconde, rayon de la curie
proprement dite, a rapport à la conservation de la foi universelle ; la
troisième, définie surtout par allusions et omissions, concerne la
production des moyens économiques utiles aux deux premières. Les compétences
de la curie sont reprises dans la constitution rédigée en 1969 par Paul
VI sous le titre Regimini Ecclesiae Universae (pour le gouvernement de
l'Eglise universelle). L'esprit de ce texte comporte la particularité,
contraire à toutes les constitutions moderne le pouvoir y est issu d'en
haut : la volonté du pape descend cascade sur toute la hiérarchie
religieuse, et n'est en rien le reflet de la volonté des fidèles. Le
pape, élu mais d'émanation divine, est infaillible. En
ses décisions sont sans appel.
La
constitution de l'Eglise est reconnue notamment par la Convention de La
Haye (1954) et par l’Unesco ; au point que le survol de l'Etat du
Vatican est interdit (aux avions, pas aux satellites). De la constitution
encore, dérive une série de lois (et règlements (du code de la route
au code pénal relevant d'un savant mélange entre progressisme et féodalisme.
Célèbre en ce sens est l'édit du substitut du Secrétaire d'Etat
(vice-premier ministre) autorisant les résidents de la Cité, il y a peu,
à posséder un chat, mais qui ne résolut pas un urgent problème : les
chats dépendent-ils du Vatican ou du Saint-Siège ?...
En
fait, le texte de cette constitution veut être l'expression formelle du
credo tous les chrétiens du
monde réunis en une "nation supranationale- se situant au-delà des
différents régimes politiques et légaux auxquels ils sont soumis.
La
curie regroupe une quarantaine de dicastères (ou ministères) les congrégations,
gardiennes de la doctrine et de la discipline religieuse : les offices,
qui publient les documents du Saint-Siège, en administrent les biens et
les affaires ; les tribunaux et les secrétariats, chargés des tâches spéciales,
Elle emploie quelques cinq cents religieux (du cardinal au simple prêtre)
et une cinquantaine de conseillers laïques soumis à une discipline
rappelant celle de l'armée prussienne, doublée d'un affairisme bien
actuel. Les chefs des dicastères sont toujours des cardinaux et sont nommés
par le pape. Ils ont sous leurs ordres des officiers majeurs et mineurs.
Tous ces gens, avant d'entrer en fonction, prêtent serment de fidélité
au pape (en latin pour les prêtres, en italien pour les laïcs), jurent
de respecter le secret d'office et, suivant la délicatesse de leur tâche,
le secret pontifical ou d'Etat.
Évolution
Les
origines et l'évolution de cette curie sont intéressantes à plus d'un
point de vue : dans l'antiquité, le vocable désignait le lieu, sur le
forum, où étaient exécutés les rites aussi bien religieux que
politiques. Successivement, il prit la signification de gouvernement, de sénat
même, puis de siège du patriarche et, avec le développement du diocèse
de Rome, d'administration centrale de l'Eglise, vers le Vème siècle. Car
l'Eglise, dans une première phase, s'organise secrètement. Une fois
devenue assez forte, elle émerge et récupère petit à petit les
structures politiques et administratives de la société où elle a pris
racine, jusqu'à les recouvrir, les monopoliser et se substituer à Etat
laïque. De la sorte, la basilique antique. grand marché couvert servira
de modèle architectural aux premiers lieux de culte, et l'austère réglement
de vie des vestales gardiennes du feu inspirera les communautés
religieuses. Et le pape, dans la suite, deviendra roi de Rome.
Quand
les croyants se multiplient et se diversifient, l'Eglise est forcée de se
doter d'une administration de la chose publique ; le thème originel de
"spiritualité" glisse alors vers la -temporalité-. A l'étape
suivante, la spiritualité n'est plus qu'une raison de façade, le ciment
qui unit la base uniquement . car gérer une société croissante signifie
créer les moyens de cette gestion et de cette croissance, c'est à dire
renforcer le pouvoir politique et économique. Le Vatican à travers les
siècles, a suivi et suit encore cette progression.
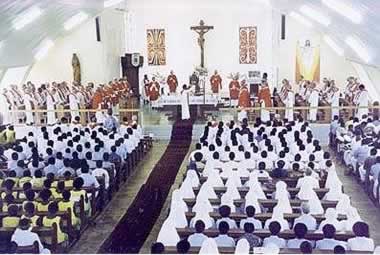
D'autre
part, le pouvoir dans l'Eglise étant une "émanation d'en
haut", la porte est ouverte à tous les abus. Le Saint-Siège peut
ainsi se permettre de participer en première ligne à la spéculation
immobilière dans la Rome moderne, ou agir sur le marché financier
international comme n'oserait le faire aucun Etat. Et en cas de litige ou
de mise en accusation, le Saint- Siège se retranche derrière la religion
et le Vatican derrière la Raison d'Etat ou vice-versa. Et de laisser
passer les remous du scandale puis, quand l'opinion publique est à
nouveau endormie, de remonter à l'assaut. Les pertes que les caisses du
Vatican subissent sont actuellement de peu d'importance quand on considère
que toute son activité économique tend, dans la rigidité la plus
totale, à la concentration des richesses sur son souverain absolu : un
système à l'épreuve du temps et des vicissitudes de l'histoire.
Mais
revenons à la curie. Sa forme actuelle se ressent très fort des
bouleversements politiques du siècle passé, que Pie XI décrivait en
1852 comme "de très graves mutations". Le Vatican, pour
compenser- la perte rapide des états pontificaux (et surtout de leurs
revenus calqua son administration sur celle des gouvernements modernes
avec, particulièrement, la création d'une structure diplomatique
autonome et modernes la veille du Congrès de Vienne (1815).
La
réforme entreprise en 1965-67 par Paul VI dans la foulée du concile
Vatican II, formalisa cette évolution en confirmant la curie dans son rôle
de gouvernement capitaliste, de pair avec sa définition de guide et de
contrôle spirituels adaptés aux dimensions désormais mondiales de
l'Eglise
Parmi
les dicastères relevons la Congrégation pour la Cause des Saints, chargée
de l'illustration, par la béatification et la sanctification de la
doctrine. La Congrégation pour l'Inquisition, terme remplacé, au début
du siècle, par "Doctrine de la Foi", dite aussi Saint-Office,
fut fondée comme premier organisme permanent de la curie lors de la
contre-réforme. Son président est Joseph Ratzinger, archevêque de
Munich et cardinal depuis 1977, et son secrétaire, jusqu'en avril 1984,
fut Jean Jérôme Hamer, né à Bruxelles cri 1916. Hamer a ensuite été
placé à la tête de la Congrégation pour les Religieux, d'où il
supervise les activités des ordres et contrôle leurs opérations de
vente et achat de biens immobiliers. Ces deux personnages sont des
dominicains traditionnalistes ; la contribution de leur ordre au Saint Siège
a toujours été l'étude et la formulation des dogmes et, par conséquent,
fut-il chargé d'organiser l'inquisition.
Le
fonctionnement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été déterminé
en 1971 (réforme de la curie) ; un "congrès des supérieurs et
officiers" du dicastère se réunit chaque samedi pour examiner
toutes les publications relatives à la foi catholique. Si elles sont jugées
non-conformes à la doctrine officielle, la Congrégation entame soit une
procédure extra-ordinaire (dans les cas mineurs où une décision est
prise immédiatement et sans le bénéfice d'un débat contradictoire) ou
une procédure ordinaire : deux experts sont nommés, ainsi qu'un relateur
"en faveur de l'auteur" (l'avocat de la défense, qui n'aura
aucun contact avec l'auteur incriminé). Après réflexion, ceux-ci
rendent leurs conclusions qui font l'objet d'un débat à l'intérieur de
la Congrégation. La sanction est décidée et contresignée par le pape.
Après quoi seulement l'auteur recevra une communication, sera éventuellement
invité à Rome, et présentera une défense écrite. Et il sera, ni plus
ni moins, amené a avaliser la sanction déjà passée aux actes. Il
pourra faire appel, mais suivant le même circuit et devant les mêmes
juges. La procédure kafkaïenne rappelle l'administration de la justice
dans les pays totalitaires.
La
Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples, dite Propaganda Fide
est, à l'encontre des autres, détachée de l'administration centrale.
Elle possède et gère ses biens propres dont les revenus, complétés par
le fruit des "journées mondiales des missions" (estimé,
actuellement, à 70 millions de dollars par an), financent ses 887
missions principales auxquelles elle a distribué 400 millions de dollars
en 1982, en plus de 24 millions destinés à la formation de nouveaux prêtres,
Propaganda
Fide et Saint-Office ont droit à la sollicitude particulière de Karol
Wojtyla, un pape qui sait mettre l'accent sur la propagande et l'image de
marque de l'Eglise. Elles ne cèdent le pas qu'au Secrétaire d'État
(premier ministre) et sont très actives : le cardinal Ratzinger, par
exemple, a pris des mesures disciplinaires contre les théologiens Hans Küng
(qui a toujours refusé de se présenter à Rome) et Edward Schillebeeckx,
un dominicain hollandais (qui, lui, a fait amende honorable et a accepté
de modifier son livre condamné). Joseph Ratzinger, encore, lançait en
mars 1984 l'offensive contre la 'théologie de la libération' par lui taxée
de "nouvelle hérésie" d'autant plus dangereuse qu'elle se base sur 'une
interprétation néo-marxiste des Ecritures'. Une importante condamnation
que celle-là, où l'on voit le Saint-Siège tenter, à distance, de
maintenir sous le joug l'Amérique latine comptant désormais une bonne
partie des catholiques dont les critères culturels et religieux sont de
moins en moins semblables à ceux de l'Europe (ce qui fait dire à
certains, non sans malignité, que la vraie place du Saint-Siège serait
quelque part entre Bogota, Buenos Aires et San Paolo)..
Joseph
Ratzinger, l'un des représentants les plus réactionnaires de la hiérarchie
vaticane, joue le rôle de 'gendarme de Wojtyla'. Le pape, en plein accord
avec sa ligne conservatrice, conférait récemment le premier Prix Paul VI
au théologien Hans Urs Von Balthazar, 80 ans, Suisse et ex-jésuite,
auteur d'une monumentale oeuvre se rattachant à la scolastique du Moyen
Age où il dit : 'L'enfer existe, mais pourrait bien être vide. L'Eglise
proclame les saints, c'est-à-dire ceux qui ont droit au paradis, mais
elle n'a jamais proclamé que quelqu'un soit damné aux enfers.' On est
bien loin, au Saint- Siège, des prétentions socio-politiques des prêtres-ministres
du Nicaragua.
Dans
la même foulée, le pape autorisait le retour du latin dans le rite de
lit messe : le latin, en soi, n'est pas réactionnaire et est même
porteur d'une part importante de la culture occidentale ; à l'inverse,
l'usage de la langue vulgaire dans la messe ne peut de prime abord être
entendu comme une conquête démocratique par lit base des fidèles. Mais
le latin a toujours été le jargon du pouvoir ecclésiastique, la langue
à laquelle le'vulgus'n'a pas accès -et de ce fait est-il le cheval de
bataille de l'évêque Marcel Lefebvre, champion du tradition n ali sme
ennemi du concile Vatican 11, suspendu Il a divinis par Paul VI, et protégé
par l'aristocratie "noire" (ces familles nobles gravitant dans
la cour papale et maintenant encore, en plus d'être depuis la chute de la
royauté la seule nobles se qui compte en Italie, un fort pouvoir économique
à travers ses propriétés terriennes et ses participations dans les
banques et sociétés liées au Vatican - Marcel Lefebvre fut l'hôte de
la princesse Isabelle Colonna, décédée il y a peu).
Tout
ceci s'inscrit dans ce que le pape Wojtyla nomme la "réforme"
et le cardinal Ratzinger, plus prosaïquement, la "restauration"
de l'Eglise en lutte contre les "excès postconciliaires,
"oeuvre d'éléments centrifuges et irresponsables". Il est vrai
que l'élargissement et la diversification de l'Eglise fait perdre son rôle
de référent absolu au Saint-Siège romain dont la curie, en réaction,
se raidit sur des positions formalistes et dont le chef, le pape, cherche
à réaffirmer son autorité (en insistant, par exemple, sur sa mission de
"successeur de Pierre"). Le mouvement, psychologiquement et
politiquernent, est bien compréhensible (les puissants se défendent),
mais quelle est sa viabilité ? Certes, le Saint-Siège s'est doté d'évêques
et de cardinaux provenant du Tiers-Monde (dont certains, vu leurs
origines, sont encore plus conservateurs que les Romains eux-mêmes), mais
ils ne lui ont jusqu'à présent que conféré une touche d'exotisme loin
de représenter les aspirations de la communauté chrétienne de base.
Joseph
Ratzinger précise encore "La restauration est souhaitable, et elle
est d'ailleurs déjà en train" - et il définit -diabolique- la
culture et la politique en Occident, tandis que celles de l'Est sont
" en faillite", que la "théologie de la libération"
entretient "le mythe illusoire de la lutte de classe" et que les
autres religions sont des "régimes de la terreur". Il invite
enfin les fidèles à "renoncer à certaines solidarités
euphoriques" (comme l'ouverture de l'Eglise à la gauche).
Suivent,
dans l'organigramme de la curie, les tribunaux (Sainte Rote tribunal de la
Pénitence, tribunal suprême de la Signature Apostolique), les secrétariats
(pour les chrétiens, pour les nonchrétiens, pour les non-croyants). Le
secrétariat pour les non-chrétiens est dirigé par Jean Jadot, un Belge
de 75 ans, diplomate de formation, ex-délégué apostolique aux USA (où,
en 1979, il organisa la visite du pape), et archevêque titulaire de Zuri
(notons que les titres de ce genre sont purement honorifiques : ils
correspondent à des 'charges en exil' depuis l'expansion de l'islam et du
communisme).
L'administration
palatine, sous la responsabilité directe du pape, comprend la Fabrique de
Saint-Pierre, vouée à la gestion de la basilique (son bilan, régénéré.parles
offrandes des visiteurs, est en équilibre), la bibliothèque apostolique
(700.000 volumes imprimés, 100.000 cartes géographiques, 65.000
manuscrits,... ), les archives secrètes (qui rendent publiques, après 75
ans, les doctiments pontificaux), la typographie polyglote, et
l'Osservatore Romano. Ce journal, auto-défini 'quotidien politique et
religieux', est un véritable chef-d'oeuvre du non-dit et du sous-entendu
où la mise en page, le type de caractère employé, la longueur des
articles jouent un rôle déterminant. Ses éditoriaux, anonymes, reflètent
la ligne politique du Saint-Siège.
La
Préfecture des Affaires Economiques du Saint-Siège, (PAE) qui fait
partie des offices de la curie, est une sorte de cotir des comptes chargée
de la vérification des dépenses et recettes et, ce qui est neuf au sein
du Vatican, de la rédaction d'un bilan unifié.
Bilan
La
publicité donnée à ce bilan vaut qu'on s'y arrête un instant. Malgré
les fortes résistances exprimées par les cardinaux prévalut, sous Paul
VI, la raison de sensibiliser tous les fidèles aux 'problèmes économiques'
du Vatican - dans le but, cela va de soi, de solliciter les offrandes en
présentant une situation catastrophique et une 'Eglise pauvre'. Ce qui ne
correspond que de loin à la réalité : les opérations (dont certaines
fort peu honnêtes., mais surtout très rentables) de l'institut pour les
Oeuvres de Religion, ou IOR ne figurent par exemple jamais dans le
compte-rendu livré aux archevêques et dont, jusqu'à la mort de Paul VI,
n'était rendue publique que la prévision du déficit (estimé à
20.240.000 dollars en 1979). Etrange pratique qui a permis et permet
encore au Saint-Siège de disposer des dons faits par les fidèles sans
devoir en justifier l'usage.
La
cause de tant de secret ? Tout d'abord, dit-on chez les cardinaux, la
divulgation intégrale des comptes du Vatican ne rencontrerait que l'incrédulité,
et aurait des effets nocifs. Toute information donnée hors contexte
serait trop facilement déformée et manipulée par les ennemis de
l'Eglise. Sans oublier le problème de fond : l'encyclique Populorum
Progressium de Paul VI ne condamne-t-elle pas les principes et méthodes
du capitalisme ?
Comment,
alors, faire admettre que l'Eglise est 'condamnée', pour se donner les
moyens de sa politique, à opérer en bourse, à posséder des intérêts
dans la grande industrie, à participer au développement des
multinationales ? Mieux vaut, dit-on au Vatican, quelques pieux mensonges
par omission et insister sur l'aspect apostolique de l'Eglise.
Enfin,
il y a les arguments techniques : comment, par exemple, aplanir la
comptabilité de toutes les activités du Saint-Siège qui s'exercent
clans les domaines les plus disparates, et avec des tentacules dans le
monde entier ? Et peut-on mettre sur le même pied le patrimoine d'une
Eglise en pays communiste, officiellement propriété de l'Etat, avec le
patrimoine d'une Eglise d'un pays capitaliste .
Les
arguments, dont certains poussés à la limite du vraisemblable, ne
manquent pas pour présenter le Vatican comme victime de la malveillance
du monde moderne, et comme victime de son propre devoir... N'empêche que
la gestion économique et les profits cachés du Vatican tiennent une
importance énorme dans l'administration de l'entreprise spirituelle - la
preuve en est qu'un des tous premiers actes d'un nouveau pape est de se
faire apporter le livre de comptes qu'il est le seul à pouvoir consulter
dans son entièreté...
L'élection
de Karol Wojtyla en 1978 devait quelque peu changer cette pratique bien
commode du secret : le Vatican passait de mauvais moments en relation avec
les affaires conclues entre les banquiers Sindona et Calvi, et le IOR.
Grand besoin était d'épousseter le symbole de l'Eglise "des
pauvres". La
création du Conseil pour l'Etude des Problèmes Economiques du Saint- Siège,
une commission cardinalice, allait rendre possible la publication d'un
bilan étoffé (bien que lacunaire : y manque toujours la voix du IOR dont
il résulte qu'en 1981 les entrées étaient de 62 millions de dollars
(dont 17 millions d'offrandes) et les sorties de 59,5 millions de dollars.
En 1982 le Conseil annonçait simplement la prévision de la dette :
quelques 30 millions de dollars. En 1983, le silence. Début 1984, la Préfecture
des Affaires Economiques s'alarmait - niais sans créer la surprise -
devant la probabilité d'un déficit de 32 millions de dollars. Avec ceci
de particulier que le Vatican déclarait pour la première fois
ouvertement chercher à susciter une augmentation substantielle des
offrandes de la part des pays riches, principalement l'Allemagne et les
USA.
Au
sommet de cette hiérarchie qui vient d'être décrite, trône un
personnage qui représente officiellement la politique et la diploinatie
du Saint-Siège : le Secrétaire d'Etat, tellement influent que certains
papes, comme Pie XII durant les 'temps difficiles' du fascisme, préférèrent
en occuper eux-mêmes la charge. Le Secrétaire d'Etat, qui veille à la
préparation et à l'exécution des décisions du pape, dirige une
administration de onze conseillers et auditeurs (tous écelésiastiques et
diplomates), un conseiller laïque, onze attachés religieux (dont, fait
exceptionnel dans les hautes fonctions du Vatican, une Révérente Mère).
Cette administration est chargée du Chiffre de la Chancellerie des
Lettres Apostoliques, de l'information et Documentation, et du Bureau
Central des Statistiques de l'Eglise.
Le
Secrétaire d'Etat est, depuis 1979, Agostino Casaroli : un homme de 70 ans, professeur à l'Académie de diplomatie du Vatican spécialiste,
depuis les années '60, des relations entre le Saint Siège et l'Europe de
]'Est, et fait cardinal par Paul VI. C'est le premier ecclésiastique a
avoir trouvé, avec tact, un langage apte à rencontrer les exigences de
l'URSS dans ses relations avec le Vatican. La carrière de Casaroli est
exemplaire : entré en 1940 dans la Secrétairerie d'Etat il est nommé
sous-secrétaire au Conseil des Affaires Publiques du Saint Siège (ministère
des Affaires Etrangère en 1961. Jean XXIII le charge de se faire son
messager à l'Est. En 1964 il est l'artisan du premier accord signé entre
le Vatican et un pays socialiste, le Traité de Budapest qui, vingt ans
plus tard, sera reconduit par les deux parties. Il s'active ensuite en
Tchecoslovaquie puis en Yougoslavie. En 1967, il devient secrétaire aux
Affaires Publiques. il sera fait cardinal en 1979. En 1981, il est à
Moscou, porteur du Traité pour la non-prolifération des armes atomiques.
Sous sa houlette, plus de cent Etats ont entrepris ou poursuivi des
relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Et il régit maintenant,
dans les coulisses, tous les rapports du Saint-Siège avec, notamment, la
Pologne.
En
avril 1984, le pape Jean-Paul Il modifiait sensiblement les attributions
de ce Secrétaire d'Etat. Il lui déléguait 'en ses nom et lieu' le pouvoir administratif et politique sur l'Etat de la Cité du
Vatican jusqu'alors du ressort de l'autorité pontificale. Casaroli
devenait ainsi une sorte de 'vice pape résident chargé de l'entièreté
du pouvoir temporel sur le gouvernement de l'Eglise ce qui laissait la
charge spirituelle de ce gouvernement à Karol Wojtyla. Le pape est donc
libre de résider en -dehors de Rome - élément important pour un pontife
voyageur comme Wojtyla - et de devenir une sorte de représentant itinérant
de l'Eglise universelle tandis que la Cité du Vatican, en son absence,
continue à remplir ses fonctions. Cette interprétation de la décision
de Wojtyla trouve sa substance dans le fait que le pape, par le même
document où il déléguait ses pouvoirs à Casaroli nommait Bernardin
Gantin, originaire du Bénin, à la tête de la Congrégation pour les Evêques
(un poste fort important, puisque c'est de lui dont dépend la désignation
des représentants de l'Eglise à travers le monde), l'office étant pour
la première fois occupé par un homme de
couleur orienté vers le tiers-monde plutôt que vers le coter de Rome.
Mais
on peut aussi penser que cette 'promotion' de Casaroli représente, dans
le plus pur style du Vatican, un éloignement. En effet Casaroli désormais
immergé dans le pouvoir temporel, risque de perdre beaucoup de son poids
dans le gouvernement spirituel de l'Eglise c'est-à-dire la curie et les
Congrégations. D'autant plus qu'il se trouve maintenant confronté,
directement, à cieux de ses ennemis de toujours : le cardinal Sebastiano
Baggio devenu président de la Commission de Contrôle pour l'Etat du
Vatican, et le cardinal Agnelo Rossi, nommé président de
l'Administration (lu Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) en
remplacement du même Casaroli
Au
Secrétaire d'Etat est adjoint un substitut - Eduardo Martinez Somalo,
archevêque titulaire de Tagore, directeur du Chiffre et des relations
avec les ambassades - dont le rôle est essentiel, puisqu'il sert de
filtre entre le Secrétaire d'Etat et le pape. Le substitut est un
personnage de tout premier plan et dans le passé récent le prédécesseur
de Somalo, Bellini, a pu à ce titre se faire le porte-parole du
conservatisme aussi bien économique que politique du SaintSiège.
En
communication directe avec le Secrétaire d'Ftat, est la Préfecture des
Affaires Publiques du Saint-Siège ou bureau diplomatique né, comme nous
l'avons esquissé, au début du XIX` siècle et fixé dans sa forme définitive
par Paul VI. Le préfet en est, traditionnellement, le Secrétaire d'Etat
et est assisté d'un secrétaire - actuellement, Achille Silvestrini, nommé
en 1970 et depuis toujours collaborateur de Casaroli. Dans le conseil de la
Préfecture, nous retrouvons l'intransigeant Ratzinger, président de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le but de ce bureau est la
gestion des rapports avec les nonciatures et les délégations
apostoliques des ambassades du Vatican, (au nombre de 113 à travers le
monde) et avec les ambassades accréditées auprès du Saint-Siège (elle
témoignent d'un lien privilégié entre les Etats et le Saint-Siège,
celui de inclus tel quel dans la constitution. Et être rafraîchi en 1984
(après six brouillons et seize ans de négociations) par le premier chef
de gouvernement socialiste italien ayant jamais été reçu officiellement
au Vatican, Bettino Craxi. Le 'nouveau' concordat qui résulte de la
manoeuvre n'est ni fait qu'un remaniement au goût du jour de l'ancien
(tandis que le traité de conciliation et la convention financière
demeurent intacts). Cet accord reconduit substantiellement les facilités
dont jouit le Vatican sur le territoire italien.
Tandis que le
catholicisme perd s'a définition de 'religion d'Etat mais que l'Etat
continue a n'avoir aucun droit de regard dans la nomination des évêques
(cas unique en Europe : en Espagne, les dignitaires de l'Eglise sont
directement désignés par le roi). Et que le cours de religion devient
facultatif dans l'enseignement, que la Sainte Rote n'a plus le monopole ni matière matrimoniale (dix ans après la rédaction de la loi
italienne sur le divorce !), et que sont abolies les normes empêchant
l'Etat de confier une charge d'enseignement à un écclésiastique
encourant des sanctions (normes d'héritage mussolinien). Ce qui, de la
part du Saint-Siège, représente de biens maigres concessions en regard
de la modification du régime des ordres religieux, du traitement du clergé,
et de la protection de son patrimoine artistique modification allant, nous
le verrons plus loin, dans le sens d'un ultérieur enrichissement de
l'Eglise et de l'Etat du Vatican, une consécration définitive : le
concordat témoigne désormais de la doctrine officielle italienne en matière
de ses rapports avec la religion dominante. Il détermine 'une plus grande
liberté de I'Eglise face à l'Etat. selon les paroles du cardinal
Anastasio Ballestrero, président de la Conférence épiscopale italienne.
L'Etat en est-il conscient ?
On
peut en douter, quand on connait le laxisme et l'impréparation atavique
de bon nombre de ses politiciens. Mais on peut aussi être assuré que les
ambiguïtés contenues dans le texte du 'nouveau' concordat ont été délibérément
voulues par ses rédacteurs de la partie vaticane, lesquels, ils l'ont
prouvé au cours d'un siècle de relations imbriquées entre le Saint-Siège
et les dirigeants italiens, ne pèchent certes pas par manque de
vigilance.
Ce
qui précède concerne essentiellement la distribution et l'exercice du
pouvoir au sein du gouvernement de l'Eglise. Autrement important est
l'aspect informel de son organisation, les détours, les axes préférentiels
et les recoupements qui en déterminent finalement, la véritable
physionomie - laquelle - dépend de la personnalité du pape régnant.
Depuis
son élection en 1978, Karol Wojtyla a su secouer la gérontocratie du
sommet, celle-là même qui a fait du Vatican un autre Kremlin. L'âge
moyen des chefs de dicastère qui était, en 1969, de 79 ans de plus vieux
en avait 90, s'est abaissé en 1984 à 67 ans de plus jeune est J.
Ratzinger, 57 ans, et le plus vieux a 77 ans. D'autre part, Wojtyla s'est
asservi avec beaucoup d'intelligence une ancienne tradition du Saint-Siège
: le cumul des fonctions qui fait que le cardinal Sebastiano Baggio gère
contemporainement douze charges et qu'Agostino Casaroli en occupe neuf,
toutes de nature politique et économique. Et la liste pourrait continuer.
Ce
cumul permet à un nombre restreint de cardinaux étroitement liés entre
eux de dominer tout l'organigramme du pouvoir et de multiplier les
communications horizontales et verticales. Ce qui, a certains égards,
peut déboucher sur des contradictions : ainsi le cardinal Caprio, préfet
de la PAE, devrait contrôler les finances du
Governato de la Cité du Vatican dont le dirigeant n'est autre que
le Secrétaire d'Etat chef absolu de Caprio... Les contradictions sont
bien sûr voulues et, en fin de compte, s'annulent dans un délicat équilibre
des forces convergeant vers l'unique pôle de décision : le pape. Reste
que seul un spécialiste est en mesure de s'y retrouver dans cette
profusion de bureaux et d'offices aux compétences voisines. Nous verrons
plus loin comment le ‘brouillage des pistes’ permet au Vatican de se
rendre quasi inaccessible et, surtout, de dissimuler la plupart des opérations
financières qu'il exécute ou l'ait exécuter.
Concrètement
le pape Wojtyla, afin de s'entourer d'une équipe fiable, a procédé en
trois étapes : en mars 1979, la mort du cardinal Villot rendait vacant le
siège du Secrétaire d'Etat qui échut, ainsi que la présidence de la Préfecture
des Affaires Publiques, à Agostino Casarofi. Giuseppe Caprio passait de
la Secrétairerie d'Etat à la présidence de l'Administration du
Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) par effet d'une dérogation
temporaire car ce poste est traditionnellement réservé au Secrétaire
d'Etat. Et Eduardo Martinez Somalo devenait le substitut du Secrétaire
qu'il est encore aujourd'hui. En 1981, la deuxième phase : Caprio quitte
l'APSA, qui retourne aux mains de Casaroli, et s'installe à la Préfecture
des Affaires Economiques ; et l'archevêque Achille Silvestrini devient
secrétaire des Affaires Publiques. L'ultime remaniement date d'avril 1984
: les pouvoirs de Casaroli sur la Cité du Vatican en sortent renforcés,
mais le Secrétaire d'Etat perd une fois de plus le contrôle de l'APSA
qui échoit au cardinal Rossi, ex-président de Propaganda Fide.
Ainsi,
la diplomatie du Vatican est l'apanage de Casaroli et de Silvestrini,
alors que sa politique économique dépend en substance de Casaroli et de
Rossi.
Jean-Paul
Il dirige donc un conseil réduit, rajeuni, aux pouvoirs concentrés, qui
s'est révélé apte à donner une forte impulsion a la rédaction du
'nouveau' concordat entre l'Italie et le Saint-Siège, et surtout à
pourvoir à la ligne de l'Ostpolitik du premier souverain pontife polonais
de l'histoire.
C'est
un vieux rêve, ce rapprochement entre l'Eglise et l'Europe de l'Est.
Curzio Malaparte explique dans son livre 'Technique du coup d'Etat' (1931)
que l'Eglise uniate de la Galicie Orientale (région frontière de l'URSS)
fut, dès la prise de pouvoir par les communistes, considérée par Rome
comme le 'pont naturel' pour la reconquête religieuse de la Russie. Les
unions, de doctrine catholique mais de rite orthodoxe, furent déportés
de l'URSS et reçurent, dans leur déplacement, l'aide des jésuites.
D'autre part monseigneur Achille Rati, futur Pie XI et alors nonce
apostolique, en accord avec le représentant du gouvernement fasciste
italien, refusa de quitter Varsovie assiégée par Trotski et l'Armée
rouge (en août 1920) dans l'espoir de se lier aux bolcheviques et de
devenir le premier prélat en contact direct avec le nouveau pouvoir du Krémlin.
Mais Trotski ne prit pas la ville, et le projet demeura sans suite.
Après
la guerre, l'idée de la détente fut réélaborée par Jean XXII et par
Paul VI et fit son chemin aidée notamment par les résolutions du concile
Vatican Il (1962-65) dont un des objectifs était de déterminer
l'ouverture de l'Eglise au monde non-catholique, et de reconnaître,
au-delà des rapports Est-Ouest, I*importance grandissante de l'axe
Nord-Sud.
L'élection
de Karol Wojtyla et l'ascension de Agostino Casaroli à la charge suprême
du gouvernement de l'Eglise sont tout de suite apparues comme la
confirmation de cette politique.
Casaroli,
conscient que Est et Ouest ont suffisamment d'intérèts en commun pour,
bien que se basant sur des idéologies opposées, renouveler périodiquement
les accords de non-ingérence, élabora petit à petit une stratégie
d'action investissant la problématique des différences entre socialisme
et capitalisme. La stratégie visant, dans l'esprit de son inventeur, à
rompre l'isolement de l'Eglise dans le monde et à faire du Saint-Siège
un sujet politique international capable de résorber le choc encore à
venir (nous sommes et
nous retiendrons ici que la commission paritaire chargée de Statut sur
ces points dans un délai de six mois, n'avait divulgué au Parlement
italien, lors de la ratification du 'nouveau' concordat, que les
"principes généraux" des nouvelles normes. Le Parlement (à
majorité démocrate-chrétienne, donc par nature bien disposé) était
alors amené à se prononcer sur un texte encore inexistant. Et d'acheter,
en somme, un chat dans un sac. Le tout au nom d'une mythique 'paix
religieuse' dont le Saint-Siège semble bien être le seul à profiter.
Une
analyse critique du concordat permet de déterminer certains de ses effets
à venir : après l'incongruité de la reconnaissance par la consfitution
clé 1947 d'un accord passé entre un régime totalitaire de fascisme) et
le Saint-Siège, l'Etat démocratique italien a finalement sanctionné
l'importance de la tradition historique catholique dans le pays. Le fait
objectif qu'il était sans doute inutile de souligner -- sinon que l'acte
représente un engagement solennel de la part de l'Etat un jugement
positif sur l'oeuvre du Saint-Siège, et dans les années Soixante) de la
rencontre entre Nord et Sud.
Ainsi
naît l'Ostpolitik du Saint-Siège définie, à la fin des années
Soixante-dix, par Agostino casaroli lui-même : Harmoniser le refus de
l'usage de la force militaire et la sauvegarde de la paix et de la dignité
du peuple tout en évitant, outre le conflit larvé, celui qui a
justement été défini 'une guerre appelée paix'. Il s'agit donc de gérer
l'équilibre de la tension à l'aide de contacts renouvelés s'opposant a
la philosophie de la guerre froide.
Tactiquement,
Casaroli se propose d' isoler les aspects positifs dans le discours
de l'interlocuteur, les valoriser, les intégrer, sans renoncer a nos
propres convictions ; induire la participation de l'autre sans ignorer les
risques que cela comporte. On donne l'impression à l'autre qu'il est le
seul à décider tout en ne lui laissant pour ce faire qu'un étroit
espace de manoeuvre.
Karol
Wojtyla se pose en porte-parole de cette Ostpolitik : étant Polonais, il
est bien placé pour amener les gouvernements de l'Est à lui prêter
attention.
Wojtyla qui, après avoir pesamment soutenu le syndicat Solidarnosc lors
d'un premier voyage en Pologne en 1979, retournait dans son pays en juin
1983 pour une visite 'à caractère exclusivement religieux et moral' d'un
genre tout particulier. Aussitôt reçu par le général Jaruzelski, il
lui réaffirmait 'l'entente et l'accord parfaits entre l'Etat polonais
et l'Eglise tout en souhaitant la fin de l'état de siège (décrété en
1981) et, en contrepartie, condamnait les sanctions économiques décidées
par les USA envers la Pologne. Une telle modération ne pouvait que
satisfaire Jaruzelski qui, à son tour, soulignait 'les valeurs communes
entre l'Etat et l'Eglise : l'intérêt de la nation, l'indépendance, la sécurité
aux frontières, l'unité, la croissance intellectuelle' - et de promettre
une substantielle libéralisation.
One
man-show
Puis,
venait le grand one-man-show du pape, en six étapes à travers tout le
pays (d'immenses réunions de plus d'un million de personnes dans les
stades, fruit de l'habile propagande du clergé) durant lesquelles
Woityla, manoeuvrant entre le mysticisme et l'hystérie des foules, définissait
Solidarnosc Comme un 'centre puissant et dynamique de la vie ouvrière,
intellectuelle et spirituelle placé sous le symbole de la vierge de Jasna
Gora et ajoutait : "Je me sens responsable de la Pologne !"
D'ou, réaction plus ou moins feinte du pouvoir (censure à la télévision,
pression politique, démenti,,,... ) et contre-réaction de Wojtyla qui
corrigeait le tir en insistant sur l'urgence pour le peuple, en vertu de la Raison d'Etat, d'accepter l'autorité du gouvernement. Ainsi Wojtyla
tout en critiquant le régime et en louant Solidarriosc, exaltait le
patriotisme et la religion comme éléments de cohésion sociale, laquelle
sous-entend la nécessité d'une victoire clé la société sur elle-même
afin d'éliminer ses tendances centrifuges. D'où, aussi le besoin d'un
dialogue avec le pouvoir justifiant en plein l'accord de non-agression
passé entre Wojtyla et Jaruzelski. Les USA prêtaient main-forte au pape
en estimant que son voyage représentait une 'lueur d'espoir' pour la
Pologne, et décidaient la fin de l'embargo en échange très significatives
de libéralisation' (et, de fait, l'état du siège sera levé un mois
plus tard).
Restait
Lech Walesa : le jour même de sa rencontre 'secrète' avec la pape,
l'Osservatore Romano écrivait : 'Officiellement, Walesa sort une fois de
plus de la scène. Nous pouvons dire qu'il a perdu sa bataille (...) ... )
Rendons-lui l'honneur désarmes.' Ce lui déclenchait un certain
mouvement de stupeur. L'auteur de l'article donnait sa démission et
affirmait qu'il n'avait fait qu'exprimer une opinion personnelle - chose
invraisemblable dans un journal où rien n'échappe à la vigilance de la
Secrétairerie d'Etat
Ayant
de la sorte préparé le terrain à Jozet Glemp cardinal et primat de
Pologne, le pape rentrait à Roule . Déjà en 1981, ait milieu des
troubles civils, Glemp n'avait pas hésité à déclarer : 'Ce matin, la
proclamation de l'état de siège nous a jeté dans la consternation ce
soir, nous sommes déjà habitués à cette parole.' Une phrase qui résonne
comme un programme politique que ses actes, par la suite, allaient
corroborer.

Le
primat, aussitôt après le départ du pape, émettait un document signé
par les évêques polonais et soutenu par Wojtyla où est formulée la
proposition de mobiliser les cultivateurs par l'intermédiaire de centres
de formation (et d'endoctrinement) parastataux, coupant ainsi l'herbe sous
le pied de Solidarnosc rural.
Le
projet comprend en outre la constitution d'un Fonds pour l'agriculture,
fruit d'une récolte de capitaux en Allemagne fédérale, aux Etats Unis
et au Canada desquels, par voie de la proximité ou de l'immigration, sont
sensibles au problème polonais pour un montant de 1.700 millions de
dollars à distribuer en cinq ans à 3 millions d'entreprises familiales
privées (représentant 75% de la production nationale). La gestion de ce
Fonds doit bien entendu être confiée à l'Eglise polonaise et lui
permettre de réaffirmer son emprise sur les campagne,, qui,
traditionnellement, sont plus sensibles à la religion qu'au communisme.
Cette monopolisation par un organisme privé (l'Eglise) de capitaux étrangers
est une entorse aux principes du polonais comporte des avantages pour
toutes les parties : l'Eglise se pose comme courroie de transmission entre
l'Etat et le particulier, ce qui accroît son pouvoir ; Moscou, qui a
avalisé la licence, se donne un vernis de libéralisme bien utile sur le
plan in- ; et le général Jaruzelski s'assure un meilleur rendement de
l'agriculture, donc une augmentation des revenus et une diminution du mécontentement
rural entraînant la perte de prestige de Solidarnosc et des prêtres
rebelles. Et le Saint-Siège tire la somme : l'équilibre entre pouvoir et
contre-pouvoir est maintenu, et chacun des bénéficiaires a de bonnes
raisons de croire que son poids a été déterminant dans la prise de décision.
Le
marché, en somme, est simple : l'Eglise polonaise (dotée d'une
organisation capillaire et d'une structure rigide, autoritaire et
dogmatique, dont la force réside dans la foi comme moteur de l'identité
culturelle et du sens de la nation) propose au régime de le seconder dans
son effort pour 'moucher' Solidarnosc en échange de quoi cette Eglise reçoit
la reconnaissance définitive et indélébile de son rôle socio-politique
dans le contrôle de la base de la société. Jozef Glemp continuait sur
sa lancée : "Peu après sa fondation, déclarait-il en mars 1984,
Solidarnosc devint une organisation politique. La moitié de ses 10
millions d'adhérents étaient inscrits au Parti communiste, ce qui
signifie que ses idéaux ne coïncidaient pas avec ceux de l'Eglise. Quand
le syndicat était au mieux de sa force, J'ai déclaré que l'Eglise
l'aurait soutenu tant qu'il aurait poursuivi sa finalité originelle : défendre
les travailleurs. Mais à un certain point( ... ) Solidarnosc est devenu
un mélange de trotskistes et de marxiste,,;
( ... ) Walesa est un indépendant qui a été manipulé et a perdu le
contrôle." En d'autres mots : Solidarnosc est sacro-saint mais s'éloigne
de l'Eglise ; cette déviance est un péché ; le sacrifice de Walesa
purifiera la masse, dont la faute a été de passer outre l'autorité de
l'Etat et de l'Eglise. Mais l'Eglise salvatrice saura remettre ses brebis
sur le droit chemin.
Tandis
que l'oeuvre de médiation continuait, une visite privée du président
polonais Henryk Jablonski à Wojtyla et Casaroli débouchait sur 'un
colloque sincère qui a touché beaucoup de thèmes importants'. Glemp
avançait : 'Il y a trop de prisonniers politiques en Pologne. La mise en
ordre du pays exige la création d'un climat politique nouveau permettant
d'éliminer les sources de tension et de représailles.' L'appel était
entendu : une nouvelle amnistie (juillet 1984) libérait 600 opposants,
dont de nombreux dirigeants de Solidarnosc. Le pouvoir appelait à la
prudence : 'Les Eglises peuvent certes se développer dans les pays
socialistes, disait Adam Lopatka, ministre des Affaires Religieuses, mais
elles doivent s'adapter à la situation.'
Tandis
que Glemp et la hiérarchie religieuse, accusés de mollesse et de
compromission, commençaient lentement à perdre de leur pouvoir effectif.
La
balle était maintenant dans le camp de Solidarnosc clandestin et des prêtres
rebelles. Parmi ces derniers : Jerzy Popielusko. Un personnage emblématique
dont le meurtre, en octobre 1984, devait donner un coup d'arrêt aux négociations
sur le Fonds pour l*agriculture et ranimer les vieux antagonismes. Mais
peu importe, en fin de compte, de savoir qui a décidé sa suppression.
Car son effet global est que toutes les factions, pour des raisons de
survie, ont resserré les rangs derrière Glemp et derrière Jaruzelski.
La mort de Popielusko entre dans la logique de la normalisation, et qui
plus est a rendu quelque lustre au charisme émoussé du chef de l'Eglise
et à la position du chef du gouvernement. Mais voyons les faits.
Jerzy
Popielusko est encore un tout jeune prêtre quant le cardinal Wyszynski,
le précédent primat de Pologne, l'envoie en première ligne (en 1980)
comme chapelain de Solidarnosc. Dès 1982 (quelques mois après la
proclamation de l'état de siège), ses 'messes pour la Patrie'dans une
paroisse de la banlieue de Varsovie deviennent la tribune de Solidarnosc,
officiellement dissou Elles rassemblent tous les mois dix ou quinze mille
personnes : des fidèles, des bourgeois libéraux, des athées convaincus.
De sa chaire, le prêtre tonne : 'Les idéaux de Solidarnosc sont ancrés
dans le coeur de millions de Polonais : lutter contre eux, c'est courir à
l'échec !'. Et il prend Wojtyla au sérieux, il le cite. Sa provocation
envers Jaruzelski et Glemp est permanente. Il doit être baillonné en
guise d'exemple pour tous les autres. Jaruzelski lui fait parvenir des
menaces. Glemp le somme de réduire son discours, pense à le faire
transferer mais sensible à la pression de la base, laisse courir. On
parle même d'appeler Popielusko à Rome et de l'ensevelir dans la curie.
Rien n'y fait : le jeune curé, originaire d'une région pauvre de la Pologne où la religion est politique et vice-versa, continue en toute
Conscience à défier la stratégie du compromis. Glemp l'aban(tonne à
son sort. La presse officielle le définit 'un fanatique. Savonarole de
Vanticommunisme'. Popielusko est devenu, selon les opinions, ou un héros
populaire, ou une variable dangereuse dans le pacte de l'immobilisme. Un
personnage incommode, en tout cas pour qui le glas ne peut que sonner. Il
disparaît, enlevé. Glemp temporise, se rend dans la paroisse de son curé
pour en chasser l'agence de contre-information instaurée par Solidarnosc.
Le Pouvoir reste muet.
Mais
Popielusk-o est déjà mort : l'exemple est donné. Par la suite, trois
officiers de la police secrète sont inculpés. Le Pouvoir sauve sa crédibilité,
proclame son innocence (et Jaruzelski en profite, au passage, pour prendre
le contrôle des services de renseignements). L'avertissement (au moins
en partie d'inspiration moscovite) est générique : il s'adresse a l'aile
la plus intransigeante et figée du pouvoir et à celle, à l'autre extrémité,
la plus libérale de l'Eglise.
Le
procès des trois responsables n'a, en soi, aucun intérêt. Ses reflets
psycho-politiques se feront pourtant voir longtemps encore : la béatification
ou la canonisation de Jerzy Popielusko, décidée par la masse,
pourra profiter à l'Eglise des martyrs sont toujours utiles, ils donnent
raison au peuple et sont un moyen de pression sur le pouvoir. Mais la
condamnation à mort des responsables de son assassinat, qui est la seule
peine satisfaisante, vu les 'largesses' du droit polonais, pourrait
contrecarrer le projet : la jurisprudence du droit canon (même si les
avis, à ce sujet, restent partagés) empêche en effet la canonisation si
du sang a été versé pour venger le candidat. L'Eglise, pour satisfaire
à la demande de la base, devrait donc solliciter la grâce (ce qui
pourrait être interprété comme une couverture des réels responsables).
Si la grâce est acceptée, elle apporte de l'eau au moulin de la frange
extrême de Solidarnosc peu appréciée par Glemp. Si elle est refusée,
elle offre a l'Eglise de Glemp une formidable occasion de propagande de
pardon n'a pas été reçu, le Pouvoir se livre à la vengeance barbare
(oeil pour œil, dent pour dent').
Le
dilemme, tellement parfait qu'on le dirait inventé de toutes pièces,
demeure. Et sa résolution est désormais confiée à la diplomatie du
Vatican et à la "politique des petits pas" de Casaroli.
La
Pologne est en train de devenir le laboratoire d'une nouvelle forme de
collaboration entre l'Eglise et l'Etat socialiste cette fois, en parallèle
avec la désagrégation de la forme traditionnelle d'assistance réciproque
avec l'Etat capitaliste libéral dominé par les sociaux-chrétiens En
fonction de quoi Karol Wojtyla aura sans doute la satisfaction de passer
à l'histoire comme le premier pape du rapprochement Est-Ouest - tâche
pour laquelle, après tout, il a été élu. Le cardinal Agostino Casaroli
donc, revient en force sur le terrain de la Pologne. Jouant sur les
contradictions, sur l'opposition entre discours de fermeture et discours
d'ouverture, il provoque ses interlocuteurs et orchestre sa campagne.
Pratiquement, cette provocation tourne autour de trois faits : une prise
de position du cardinal Ratzinger, une autre de l'archevêque Marcinkus,
et un voyage manqué de Karol Wojtyla en Lituanie.
Joseph
Ratzinger, le dirigeant du Saint-Office, ayant publié en septembre 1984
une 'Instruction' relative à la 'théologie de la libération' où le
marxisme est défini comme 'la honte de notre temps' laquelle, 'justement
sous prétexte de leur offrir la liberté, maintient des nations entières
dans des conditions d'esclavage indignes de l'homme'. Même si 'le
discours ne peut être entendu comme une approbation, même indirecte, des
oppresseurs de droite', tout le reste du document est empreint d'une
analyse socio-politique vieille de cinquante ans et ne tenant aucun compte
de la diversité actuelle du marxisme à travers le monde.
Puis,
il y a le cas de la Lituanie, l'une des Républiques baltiques de l'URSS
dont 85% des 3,5 millions millions d'habitants sont catholiques et qui de
ce fait (en plus d'être voisine de la Pologne) est depuis toujours dans
la mire du Saint Siège. Afin de forcer le blocus soviétique, le pape s'était
d'abord fait inviter en 1983 par les évêques lituaniens à un 'pélerinage
spirituel' en l'honneur du jubilé de Saint Casimir, le patron de la
Lituanie. L'URSS y opposait, par deux fois, son veto. Même refus envers
Casaroli, qui voulait aller conclure le jubilé du saint. Et pour cause :
juste avant, un document signé, entre autres, par Paul Marcinkus, archevêque-financier
d'origine lituanienne, définissait la République baltique comme 'un pays
occupé par des étrangers' et soumis 'aux
dures conditions d'un régime impitoyable'. Sans compter que le
Saint-Siège, aujourd'hui encore, -entretient une nonciature et une
ambassade de la Lituanie indépendante.
Cette
tentative de voyage en Lituanie, aussi bien que le document de Ratzinger,
semblent donc être autant de coups de sonde pour ,savoir jusqu'où aller
trop loin', comme disait Cocteau, afin de permettre à Casaroli par la
suite, de développer un discours plus nuancé tenant compte des réactions
des interlocuteurs, qui ne peuvent que se découvrir, et fait de ces
petites phrases sont le SaintSiège a le secret (ainsi déclarea-t-il à
propos de l'Instruction de Ratzinger : 'Je n'étais pas présent à la
discussion' - ce qui peut signifier qu'il n'en partage pas la substance,
comprenne qui voudra). Tous ces mouvements servant à préparer un éventuel
voyage de Wojtyla et de Casaroli en Urss (on en parle depuis 1983). Ne
serait-ce pas là la consécration, offerte par Moscou sur un plateau
d'argent, de la politique du Saint-Siège en Pologne ?
L'Ostpolitik
papale, en tout cas, devait déjà être corroborée par Giulio Andreotti,
ministre italien des Affaires Etrangères, démocrate-chrétien, qui en décembre
1984 à Varsovie, se déclarait favorablement impressionné par la
normalisation et insistait sur le fait que serait 'tout à fait erronée
la politique de la mise au ban de la Pologne par l'Occident'. Ce dont il
faudrait encore convaincre la population du pays, pour laquelle les
sanctions économiques occidentales sont la marque de l'intérêt que
l'Ouest porte à l'Est...
Il
nous faut encore remarquer que la Pologne est la base logistique de
'l'Eglise du silence' : Rosa Luxembourg, dans les années Trente, y voyait
déjà le centre culturel dont dépendait l'unification, au départ de
l'Occident, de toute la région baltique. Pouvait-elle imaginer qu'un
demi-siècle plus tard, l'Eglise allait reprendre le même thème adapté
à ses critères ? Le fait est que Henryk Gulbinowicz, archevêque de
Braslavia, s'intéresse à la Tchécoslovaquie, que Ignacy Tokarczuk, évêque
de Pozemsy, a les yeux tournés vers Lvov (ex-Leopoldi, la capitale
culturelle du royaume de la Pologne maintenant en Ukraine), et que Edward
Kisiel, évêque de Bilystok connaît fort bien la Biélorussie. Ceux-là,
et bien d'autres, soutiennent un vaste réseau d'assistance aux
catholiques des Républiques baltiques (Estonie, Lituanie, Lettonie, Biélorussie,
Ukraine) de teinte nettement anticommuniste et dont l'influence s'étend
jusqu'à l'Oural.
Nord-Sud
Comme
il a été dit. l'Ostpolitik du Saint Siège tend à prévenir et donner
l'impulsion à sa politique des relations entre Nord et Sud. Celle-ci a été,
jusqu'à présent et avant tout, déterminée par les voyages du pape
Wojtyla qui cherche a lui Imprimer un élan de modernisme faisant oublier
le colonialisme missionnaire encore à l'honneur au début du siècle.
Le
pape se déplaçait en mai 1984 en Orient, sur ce 'front du Pacifique'
communément indiqué comme la 'nouvelle frontière' du monde (il avait déjà
visité les Philippines et le Japon en 1981 ). Avec, tout d'abord, une
escale plus que technique a Fairbanks (Alaska), où il devait rencontrer
le président américain Ronald Reagan, retour de Chine.
L'entrevue
était importante : pour Reagan, c*était l'occasion de faire les yeux
doux aux 50 millions d'Américains catholiques de quart de la population)
en prévision des élections de novembre de la même année , pour
Wojtyla, il s'agissait de signaler au monde l'intérêt que porte le Saint
Père à la Chine qui, avec son milliard d'habitants, représente le plus
grand réservoir de fidèles potentiels, donc de pouvoir.
Le
'cher peuple chinois', comme dit Wojtyla, s'est en effet de plus en plus
détaché du catholicisme : après la rupture des relations diplomatiques
avec le Saint-Siège en 1949 et l'expulsion du nonce apostolique en 1951,
la répression s'est abattue sur les fidèles durant la Révolution
culturelle.
La
restauration de Deng Xiaoping leur apporta un soulagement de courte durée,
puisqu'ils devaient à nouveau être persécutés en 1981. Pour compenser,
les autorités fondaient en 1957 l'Eglise patriotique, de pure obédience
marxiste, et à laquelle une bonne partie des fidèles fait désormais référence.
Parallèlement subsiste une Eglise clandestine liée au Vatican. Pour
conquérir ce vaste marché de la Chine, le Saint-Siège est prêt à
renoncer à ses évêques chinois en exil et aux relations diplomatiques
avec Taiwan. Mais il y a contradiction : reconnaître la Chine
continentale signifie pour le Saint-Siège englober l'Eglise patriotique
qui ne l'entend pas de cette oreille et abandonner l'Eglise clandestine,
le seul appui du pape dans le pays et le seul groupe à en reconnaître
l'autorité. Qu'à cela ne tienne, Wojtyla récemment encore nommait
devant les instances diplomatiques le sous-continent asiatique dont,
disait-il, 'l'Eglise suit toujours avec respect et intérêt les
aspirations et le dynamisme'.
Après
Fairbanks, l'envoi pour la Corée du Sud, le "pays du matin
calme". 40 millions d'habitants, une Eglise en pleine expansion :
200.000 catholiques en 1945, 1.700.000 en 1984. l'aux de croissance : 10%
par an. Et un respect total de la hiérarchie assorti d'un conformisme de
rêve. Wojtyla y est accueilli comme le 'roi et de fait, il endosse
'l'étole de l'antique dragon', copie (-tu manteau de la dynastie Yi, du
XIVème siècle).
Dans
un monumental spectacle à épisodes, il cite Confucius, courtise les
bouddhistes qui n'en demandaient pas tant, évite de nommer la dictature,
glisse sur la division du pays, se livre à une frénétique activité de
baptêmes, ordinations, canonisations (103 saints en une seule séance,
pour lesquels le Saint-Siège a fourni une dispense ad hoc), visite une léproserie
(où il laisse un chèque de 25.000 dollars), et s'adresse aux
travailleurs pour critiquer aussi bien socialisme que capitalisme. Au
tableau, ne manque pas la psychose de l'attentat : un 'déséquilibré' se
jette sur la voiture papale. Son revolver était de plastique ?
Qu'importe, tout est bien qui finit bien, et Woityla s'en va en emportant
'l'image d'un pays ordonné et mûr'.
Un
coup d'aile, et nous sommes en Papouasie Autres moeurs, autres discours.
Aux danseuses aux seins nus qui, depuis les progrès de l'ethnologie, ne
font plus scandale dans les missions, le 'grand sorcier qu'est devenu
Wojtyla distribue des médailles, célèbre une messe en forêt (dans un
endroit touristique), et proclame: «Vous qui croyez aux bons esprits et
craignez les mauvais, remettez-vous en à Saint Michel, c'est un bon
esprit.» Le show se déplace ensuite aux Iles Salomon.
Puis,
enfin, la Thaïlande. Très peu de catholiques, là-bas : l'étape dure
une demi-journée, avec réception de la part de la famille royale, Rolls
Royce et une visite de dix-sept minutes au patriarche bouddhiste Vasna
Tara. Ça a été comme ça peut aller avec un bouddhiste, commentera plus
tard le pape. Il était enfermé dans son monde, mais il a été très
gentil. Il m'a demandé si je ne souffrais pas de la chaleur et si je
voulais m'arrêter quelques jours chez lui'. La Thaïlande : là où, sous
la protection du pape, l’Orient et l’Occident ne se sont pas rencontrés....
Tout
de même, ce voyage demeure une grande mise en scène au minutage
extraordinairement efficace. La caravane pontificale s'est mue au rythme
des retransmissions télévisées par satellite, sans manquer un seul
rendez-vous avec la mondiovision, et contournant, de Fairbanks à Bangkok,
la Chine et l'URSS
La
même caravane devait, quelques mois plus tard, reprendre le vol pour le
Canada, le plus long voyage pontifical à cette date, ou Wojtyla portait
une condamnation définitive de la "théologie de la libération- (c'était
en septembre 1984 : le pùre Leonardo Boff venait d'être convoqué à
Rome). Passant de l'Atlantique an Pacifique des communautés de pêcheurs
de Terre-Neuve aux réserves indiennes (et manquant les Esquimaux pour
cause des mauvaises conditions atmosphériques), avec une étape à Montréal
où, dans le stade, deux cents figurants lui rendaient hommage de chorégraphe
était celui des Jeux Olympiques), Karol Wojtyla se livra a l'illustration
de la doctrine sociale du Vatican : le socialisme a tous les torts,
l'unique faute du capitalisme est de distribuer inégalement les
richesses. Suivait un làcher de ballons ou un chant choral. Puis : 'Le
Sud pauvre jugera le Nord riche !'
L'idéal
est la paix, le progrès, la justice. Le ton est à la prophétie, à
l'apocalypse (nucléaire). Mais l'Eglise est là, qui sait pardonné - il
va de soi que pour être pardonner, il faut d'abord avoir commis la faute
: le Nord qui s'est enrichi, et qui encore s'enrichit en exploitant le
Sud, doit se repentir et sera écouté par le Saint Père. Et par antithèse
le Sud des regards se tournent vers l'Amérique latine et ses
prêtres-politiciens,
ne peut avoir raison avec sa théologie marxisante, il doit au contraire réapprendre
à excuser les exploiteurs dûment confessés.
Ce
qui, dans l'ensemble, correspond aussi à la politique économique du
Vatican : lequel, nous y reviendrons, n'a jamais hésité à s'associer
aux opérateurs les plus réactionnaires pour assurer un renouvellement -
et, le plus souvent, un accroissement - de ses richesses. Quitte, au
besoin, à faire plus tard amende honorable.
L'insertion
du Saint-Siège en tant que médiateur sur l'axe Nord/Sud trouve encore
une illustration dans la récente affaire de Malte (320.000 habitants, 85
% de catholiques et une Eglise plus que puissante). En septembre 1984, le
premier ministre Dom Mintoff se prononçait à l'improviste pour la
gratuité de l'enseignement. Ce qui allait a l'encontre des intérêts des
soixante-douze écoles confessionnelles de l'île (20.000 étudiants) qui
refusaient de commencer l'année scolaire. La 'guerre scolaire' était déclarée.
Le
bras de fer dura deux mois, et fut émaillé de manifestations violentes
et même d'actes de terrorisme. Rome appuyait en tous points la fermeté
de son évêque. En novembre, un accord provisoire était souscrit :
l'Etat s'engageait à financer les écoles catholiques durant un an, en
contrepartie de la rédaction d'une liste complète des biens ecclésiastiques
(afin d'estimer le réel besoin d'aide publique de chaque institut).
L'accord
qui renforce l'emprise culturelle de l'Eglise maltaise, fut signé à un
moment particulier : juste alors, Malte renégociait avec le gouvernement
de Rome le traité de 1980 portant sur la protection militaire de l'île
par l'Italie, intégrant une subvention de 60 millions de dollars et la
permanence d'une mission technique. Les nouvelles propositions italiennes
étant jugées peu crédibles, Dom Mintoff s'adressa à Kadhafi (la Lybie
avait déjà été présente à Malte jusqu'en 1979) qui, surenchérissant,
offrait pétrole et aide militaire directe.
On
comprend mieux l'enjeu de ce retournement d'alliance quand on Sait que
Malte se situe à 110 kilomètres de la Sicile et à 350 kilomètres de la
Lybie, et fut surnommée par les Anglais "la forteresse de la Méditerranée"
durant le dernier conflit mondial. Le bas profil maintenu par le
gouvernement italien durant les négociations s'explique par la crainte de
voir Malte s'adresser à l'URSS qui ferait n' importe quoi pour acquérir
une base maritime couvrant la région moyen-orientale. En somme, le retour
de Kadhafi sur l'île n'est qu'un moindre mal.
D'autre
part, le Saint Siège tire un avantage direct de cette présence lybienne.
Sa séculaire implantation dans l'île lui permettra d'entrer en contact
rapproché avec un des chefs de l'Islam. L'Eglise s'est toujours montrée
hésitante dans ses avances envers les musulmans trop souvent désunis.
Kadhafi pourrait devenir le juste interlocuteur du Saint-Siège (et à
travers lui, de l'Occident) car il représente un régime fort et
monolithique, tout aussi monolithique qu'apparaît le gouvernement de
l'Eglise.
A
ce sujet, ce n'est certes pas par hasard que le successeur de Dom Mintoff
qui vient de se retirer de la politique active, soit Carmelo Mifsud
Bonnici, auparavant ministre de l'Instruction (directement impliqué Dans
la 'guerre scolaire') et dont un frère est archiprêtre.
Image
et conformisme de masse
Ainsi
la diplomatie déployée par le Saint-Siège joue-t-elle sur le théorème
des extrêmes opposés (qui évite, dans tous les cas,, de devoir se démentir),
ce qui amène à dire tout et le contraire de tout, dans une pratique
frisant souvent la schizophrénie.
Schématiquement,
il s'agit soit de réaliser un compromis (ou une compromission ?) avec des
régimes forts de droite ou du centre, afin de peser sur l'équilibre
entre socialisme et capitalisme, soit de tenter une récupération des
utopies politico-religieuses (cfr. la 'théologie de la libération'),
visant cette fois à modifier l'équilibre en sa faveur. Les deux thèmes
sont traités à travers l'élaborat on de la dichotomie bien-mal (bien et
mal étant, cas par cas, redéfinis). Cette diplomatie insiste d'abord,
comme il a été dit, sur l'axe Est-Ouest, et y introduit une variable
nouvelle et pressante, le TiersMonde. Nous avons ainsi une sorte de
tableau à deux entrées (bien, mal) et à trois variables (Est, Ouest,
Tiers-Monde) sur lequel le Saint-Siège déplace ses pions selon un nombre
restreint de combinaisons possibles. Deux de ces combinaisons sont le
refus total de l'Urss et l'appui plus ou moins camouflé a Ronald Reagan.
On
ne s'étonnera pas du parallélisme qui se dessine entre la personnalité
de Reagan et celle du pape Wojtyla. Tous deux sont des hommes de spectacle
dont la présence au monde est assurée par l'image projetée à travers
les mass media. On connaît, à ce propos, le passé cinématographique de
Reagan, mais peut-être ignore-t-on le spectacle de music-hall intitulé
'One World One Peace (musique de Francy Boland et Tito Fontana, interprétation
de Sarah Vaughan) commandé par Wojtyla sur base de ses recueils de poésie,
et dont il existera bientôt des versions sur disque en anglais, italien,
portugais, allemand et espagnol des grandes langues du catholicisme).
Reagan comme Wojtyla est un 'homme de façade' derrière laquelle
s'activent de très compétentes équipes de technocrates responsables des
décisions qu'il transmet à son tour par la télévision. Le taux d'écoute
de tous les deux dépend essentiellement de l'intensité du charisme
libérateur
qu'ils emphatisent sur l'écran. L'un comme l'autre recourent au spectre
de l'apocalypse exprimé en idées sommaires. Ils jouent aussi sur la
contradiction entre les risques de la 'nouvelle frontière'
(technologique, économique, ou religieuse) et les valeurs traditionnelles
qu'ils prônent, le tout assaisonné d'accents prophétiques (ils se
disent mandatés par Dieu). Ils privilégient, dans la communication, le
moyen télévisuel qui offre une représentation 'froide' (c'est-à-dire
sans participation) où le contact humain est réduit à sa plus simple
expression et ils déploient
beaucoup d'astuce pour faire croire au contraire.
La
magie, dans cette communication, est celle du plus grand dénominateur
social, lequel a pour composantes le conformisme de masse, le
triomphalisme et la répétition. Par eux, Reagan comme Wojtyla se
constituent en objet de consommation immédiate dont ils tentent de
saturer le marché.
Et
encore : l'activité du pape crée des remous qui, à l'échelle locale,
peuvent être jugés outranciers mais confèrent suffisamment d'énergie
cinétique à leurs ondes de choc pour qu'elles se propagent jusque dans
les zones les plus reculées de la planète, le fait est que, plus on s'éloigne
de Rome, plus le pape bénéficie d'une renommée positive. L'illustration
la plus flagrante de cette activité sont ces voyages pontificaux dont
nous avons esquissé quelques aspects et qui sont décrits par
l'Osservatore Romano : 'une manière de communier avec tous et avec
chacun, une manière de se concilier concrètement aux hommes des années
Quatre-vingts en marche vers l'An 2000'. Triomphalisme, encore, et
tentative d'accréditer l'existence d'un dialogue avec la masse, alors que
celui-ci n'existe qu'avec la classe politique dirigeante, dont le pape ne
se sépare presque jamais.
Plus
concrètement, Reagan et Wojtyla partagent deux grandes préoccupations :
la Pologne et le Nicaragua, et aussi un triste privilège : celui d'avoir
été victime d'un attentat (dûment manipulé par les mass media).
Karol
Wojtyla détient aussi un record : en six ans de pontificat, il totalisait
en janvier 85 soixante-dix voyages, dont vingt-six hors de l'Italie, pour
un total de 336.000 kilomètres, soit plus de huit fois le tour du globe.
Evêques
et cardinaux
Avant d'en venir aux finances du
Vatican, dernier mot à propos du synode des évêques et du Sacré Collège
de,, Cardinaux. Le synode des évêques, organe consultatif créé par
Paul VI cri 1965 et comparable à une chambre des députés, comprend
quelques deux cents représentants
des Conférences épiscopales nationales (la première a été fondée en
Belgique en 1830 : elle est actuellement dirigée par le cardinal Godfried
Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles). La fin de ces conférences
est de servir d'écran entre les Etats et le Vatican qui, étant lui-même
un Etat. Il peut intervenir directement dans leurs affaires intérieures.
A elles, par exemple, revient la tâche de désigner le 'bon vote' en cas
d'élection politiques. L'existence du synode introduit quelque élément
de 'démocratie dans le gouvernement de I'Eglise, puisque la plupart de
ses membres sont désignés par un scrutin dans la hiérarchie religeuse
Le Sacré Collège des Cardinaux, l'ex-parlement du pape, joue un rôle
plus important. Les cardinaux, nommés par le pape et citoyens de droit de
la Cité du Vatican, sont au nombre théorique de 129 (il y en a
actuellement 126). Ils prennent leur retraite à 75 ans et ont encore
droit de vote en conclave (élection du pape) jusqu'à 80 ans (97 d'entre
eux n'ont pas atteint cette limite d'âge). Ils ont le rang de prince du
sang, et détiennent le titre d'Eminence. La plupart d'entre eux habitent
à l'intérieur ou à proximité immédiate de la Cité, dans de luxueux
appartements mis gratuitement à leur disposition par le Saint Siège.
Leur traitement, légèrement inférieur à celui d'un sénateur Italien,
se complète d'indemnités, d'offrandes personnelles, et des bénéfices
pour la protection d'ordres (privilège théoriquement aboli). Ils sont le
pilier du gouvernement de l'Eglise et Il n'est pas de décision ou de
document qui, avant d'être ratifié par le pape, ne soit discute par eux.
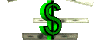 Le
Governatorato Le
Governatorato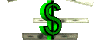
Du
point de vue matériel, l'existence du Vatican est assurée par le
Governatorato de l'Etat de la Cité, dont les activités sont contrôlées
par une commission cardinalice, Son président l'archevêque Paul
Marcinkus y assure le pouvoir exécutif.
Les
dépenses de l'Etat sont essentiellement constituées par l'entretien des
édifices et des musées, l'approvisionnement de la Cité en biens de
consommation et d'équipement. le traitement des employés et des gardes
suisses, et le fonctionnement de la radio vaticane. Ses revenus
proviennent de la vente des timbres (3.750.000 dollars en 1976), des entrées
aux musées (2 millions de billets vendus durant l'année Sainte de 1975),
de la mise sur marché de la monnaie vaticane (avec une circulation
limitée à 100 millions de Lire ; l'émission est à charge de l'Hôtel
des Monnaies d'Italie), et de l'exploitation des terrains de culture que le Vatican possède
un peu partout en Italie, Le bilan de la Cité est cri général, en déséquilibre.
Un délégué spécial laïque, le marquis don Giolio Sachetti épaulé
par un conseil de noble-romains, en surveille les entrées et les
sorties.
La
radio Vaticane, essentiel instrument de propagande, émet à partir
d'installations situées en dehors de Rome (sur utile propriété
extraterritoriale) et emploie 260 personnes dont 65 laïcs des techniciens
surtout, de 35 nationalités différentes. File diffuse des programmes
d'une longueur moyenne de quinze minutes en 32 langues y compris le mandarin
!) Leur contenu est directement soumis à l'approbation de la Secrétairerie
d'Etat. Les coûts lié à cette radio, comparés à ceux d'autres émetteurs,
sont relativement réduits bien qu'elle n'accepte pas de publicité. Elle
est actuellement en phase de modernisation, dont la dépense
extraordinaire (près de 10 millions dollars, dont 3 millions pour une
antenne pivotante unique au monde) est à charge de la Secrétairerie
d'Etat. Parallèllement, vient d'être créé un centre de production télévisée
travaillant à la diffusion de l'image charismatique du Saint Père : son
premier reportage, sur le voyage de Wojtyla à Lourdes., a été diffusé
par les télévisions occidentales et acheté un peu partout en Amérique
latine.

La
radio vaticane est aux mains des jésuites. Leur ordre, Fondé au XVIème
siècle pour aider à 'la conversion des courtisane, au baptême et à la
défense des juifs', a toujours prêté son concours, dans les domaines
intellectuel, culturel et de la communication, à l'administration de
l'Eglise. Un Belge fait partie de son 'gouvernement’ : Simon Decloux 53
ans, l'un des quatre conseillers du 'général' Hans Peter Kolvenbach.
En
substance : l'Osservatore Romano est dirigé par Mario Agnes ex-président
de l'Action catholique, puissante organisation italienne : le Service de
Presse du Saint-Siège est géré par Joaquin Novarro-Valls, Espagnol et
membre de l'Opus Dei ; la télévision se développe sous la houlette de
Communion et Libération, autre influente organisation catholique; la
radio, comme il vient d'être dit, est aux mains des jésuites ; l'Opus
Dei, encore, est bien introduit dans le Conseil pontifical pour la famille
(chargé de divulguer et de faire appliquer l'enseignement de l'encyclique
Humanae Vitae). Le tout est chapeauté par la Commission pontificale pour
les communications sociales, dirigées par d'étroits collaborateurs du
pape. Karol Wojtyla dispose là d'instruments dociles veillant à
l'efficace diffusion de son image. Et, même, faisant vigilance en-dehors
du Vatican.
Récemment,
un vaticaniste (ainsi nomme-t-on les journalistes spécialisés dans les
affaires du Saint-Siège) publia un article où était, entre autres
jugements, jugements positifs, critiquée l'attitude du pape-voyageur. Le
journaliste raportait les témoignages d'autorités théologiques
exprimant des doutes quant à la valeur du triomphalisme mondain de Karol
Wojtyla.
Réaction
foudroyante du Vatican : le lendemain, un communiqué officiel repoussait
'avec indignation le travestissement des pélerinages du pape' ;
l'Osservatore Romano, par la plume de son directeur, estimait que
l'article 'transpire de l'anticléricalisme le plus démodé, sourd et
sordide', fruit du 'néo-intégrisme radical-clérical
du laïcisme' lequel 'a peur de ce que le pape, allant en personne
vers tous les peuples, se courbant, même physiquement, vers l'homme
concret là où il souffre, bouleverse les mentalités, les méthodes, et
les systèmes d'un néo-féodalisme fermé sur lui-même (lui, çà et là,
de façon parfois évidente, mais le plus souvent subtile, blesse la
dignité de la personne'. Et une sanction était prise : le journaliste
visé perdait le privilège (payant) d'accompagner le pape dans son
prochain voyage en Amérique Centrale.
L'avertissement
est brutal : il est interdit de critiquer le pape, même a travers le témoignage
de tiers. Ce qui n'empêche ce pape de prêcher partout la liberté
d'expression. L'ultime sanction du genre remonte à 1974, quand un
correspondant avait publié une caricature jugée offensive à l'encontre
de deux évéques sud-américains qui défendaient ouvertement l'oeuvre du
général Pinochet.
Le
pape-patron
Le
personnel employé au Vatican comprend, au total, 3000 personnes. Le
Governatorato à lui seul en absorbe 1.400, presque tous laïcs et chargés,
sous la direction de religieux, des tâches techniques. Leur traitement
est inférieur au minimum vital reconnu en Italie où la plupart d'entre
eux habitent (et où ils sont exonérés des impots).
Malgré
un horaire de travail désormais de 36 heures semaine et la possibilité
de bénéficier de quelques avantages matériels (produits détaxés,
etc), les conditions d'existence de ce personnel laïque demeurent précaires.
Autre est le cas des employés religieux, dont les besoins essentiels
comme le logement et la pension sont assurés par leurs ordres respectifs.
L'évolution
de la prise de conscience et la lutte du personnel laïque est typique de
l'abîme qui sépare la théorie sociale proclamée par le Saint-Siège et
la pratique de cette théorie dans ses propres murs.
Jusqu'au
début du XXème siècle. l'employé du Vatican recevait une compensation
périodique, à laquelle venait s'ajouter les 'incertains', c'est-à-dire
une partie du chiffre d'affaires réalisé par son bureau et laissé, par
l'administration centrale, à disposition du chef de service (un
religieux) qui la distribuait à date fixe et suivant une hiérarchie et
un rite compliqué. Chaque dicastère avait son règlement propre. Il en résultait
de profondes inégalités dans les revenus, et aussi une dépendance
totale de la personne vis-à-vis du patron. Un système moyenâgeux -
alors que l'encyclique Rerum Novarum condamnait l'asservissement de
l'homme par le travail - les 'petits chefs', toujours attentifs à bien
faire pour accroître leurs privilèges jouaient un rôle prépondérant.
Ce
n'est qu'en 1979, à la lueur des luttes sociales alors en cours en
Italie, que les laïcs du Vatican réussirent à imposer l'idée d'un
syndicat , lequel, pour ne pas choquer la susceptibilité des vieux
cardinaux considérant ce genre d'organismes comme autant d'associations
de malfaiteurs prit le nom d'association ne pouvant agir qu'en tenant
compte du milieu particulier, de la parcimonie et des 'disponibilités réelles'
du Saint-Siège. Cette association, qui doit aussi être autonome, indépendante
et apolitique, cherche à se faire l'expression pratique de la doctrine
Sociale de l'Eglise et l'exemple concret de l'enseignement du pape. Une
offre que même un souverain pontife conservateur comme Wojtyla ne pouvait
repousser lui qui prêche que le travail est la fonction de l'homme qu'il
doit en valoriser la dignité, et que les syndicats défendent de justes
droits, ...
La
constitutution de l'association des employés fut formalisée en 1980 lors
d'une audience privée de deux heures entre ses représentans le pape et
le Secrétaire d'Etat (un privilège !). Une comission dirigée, pour la
part du Vatican, par Jan Schotte Belge, mission de Sheut et archevêque
titulaire de Silli n'a à cette heure pas encore rejoint un accord sur un
contrat de travail unifié. Ici encore, comme chaque fois qu'il s'agit de
négocier, le Saint-Siège vise à l'usure : il a le temps, ce qui n'est
pas le cas de ses dépendants qui ont charge de famille.
Les
employés, pourraient recourir à la grève pour débloquer la Théoriquement,
ce droit ne leur est pas nié. Mais, il est considéré comme non
opportun" (une Injonction qui, pratiquement, équivaut à une
interdiction) et est inclus dans la catégorie de la conflictualité
permanente et la lutte de classe vers laquelle la revendication, de
personnel ne peut en aucun cas «glisser». Le patron sait se défendre.
Retenons
encore que les employés du Vatican ne bénéficient pas de la garantie
d'une juridiction propre du travail, et que donc les licenciements restent
a la discrétion des autorités. La menace, en cas de non-conformisme est
flagrante. Bel exemple de duplicité, pour une dont est issue la deuxième
centrale syndicale italienne, ut lipour mi pape ardent souteneur des
droits et lides grèves de Solidarnosc. Mais il est vrai que tout cela se
passe 'à l'étranger', que Solidarnosc (en définitive récupérable on
l'a vu) se rebelle contre le communisme, et que le syndical catholique
italien lutte contre l'emprise de la gauche.
Le
tribunal civil du Vatican a été amené en 1984 a émettre Pour la première
fois une sentence en matière de travail. Trois journalistes allemandes de
la radio, avec respectivement douze, neuf et huit ans du service, rétribuées
entre 15 et 18.000 Lire par jour (un salaire inférieur à celui d'un
journalier agricole dans les régions les plus pauvres de l’Italie),
avaient été licenciées pour 'incompétence professionnelles - en réalité,
pour incompatibilité de caractère avec leur nouveau chef de service. Préférant
ne pas envoyer au pape, leur chef suprême, une supplique à laquelle il
aurait été opposé une fin de non-recevoir, elles firent recours en
justice. Le tribunal du Vatican, seule juridiction compétente, rejeta la
demande en fonction d'une loi fasciste de 1926 (soit quarante-six ans
avant la rédaction du statut des travailleurs) concernant 'l'emploi a
temps indéterminé avec rétribution à la pièce' qui indique que le
patron ne peut en aucun cas être poursuivi s'il a versé une indemnité
de licenciement. Et cette indemnité, bien maigre, avait été versée aux
trois, journalistes juste avant le 'procès'.
Le
Vatican s'est une fois de plus servi de l'ambiguité entre droit canon (déterminant
la compétence) et droit italien (déterminant la sentence).
Karol
Wojtyla, si fier de son passé d'ouvrier ne semble pas prêt à admettre
une opposition institutionnalisée sous son propre toit. Pour lui, même
si l'association des employés du Vatican a réussi à ébranler les
rapports médiévaux de dépendance (à la fin du XX' siècle !), tout
doit continuer à se dérouler à l'enseigne du paternalisme entre les
travailleurs de seuls au monde à jurer fidélité à leur patron et
l'infaillible propriétaire des moyens de production, c'est le pape. Sans
compter que celui-ci considère encore le travail de ses dépendants comme
un privilège, un apostolat, une mission.
A.P.S.A.
Les
finances officielles et déclarées du Saint-Siège, et qui ne représentent
qu'une infime partie des affaires brassées par lui, sont du ressort de
l'Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (APSA) dont la
fondation remonte à 1878, quand le pape, au moment de l'unification de
l'Italie, dût pour subsister se transformer de latifuduntiste en
capitaliste, et que les revenus officiels du Saint-Siège se trouvèrent
drastiquement réduits aux offrandes principalement des fidèles européens.
La
tâche de l'APSA est d'organiser financièrement l'administration (dicastères,
archives, bibliothèque_), de pourvoir aux investissements et à tout
mouvement de capitaux. Sous sa forme actuelle, l'APSA est contrôlée par
une commission de cinq cardinaux et se compose d'une section ordinaire
(elle pourvoit à l'entretien du synode des évêques, du Collège des
Cardinaux, du Vicariat de Rome, des universités et collèges pontificaux,
de l'Osservatore Romano, de l'administration palatine, etc…) et d'une
section extraordinaire conçue pour gérer les compensations versées par
l'Italie au Saint-Siège après la signature, en 1929, du premier
concordat pour un montant de 802 millions de dollars de l'époque (et réputées
'limitées au strict minimum'). Ce capital fut investi en bonne partie en
titres solides. Récemment, l'APSA a acquis des obligations et actions des
sociétés Gulf Oil, IBM, General Electric General Motors Shell, etc. Elle
a pour conseillers les banques Rotshild et Hambros de Londres, la Chase
Manhattan, la First National et la Morgan Guaranty de New York, et le Crédit
Suisse de Zurich. Le montant exact de son portefeuille est une fois de
plus tenu secret et comprend, outre la totalité du patrimoine mobilier,
une petite partie du patrimoine immobilier de revenu.
On
a pu parler, à un certain moment, d'un total de quelques 300 millions de
dollars.
L'APSA
est d'autre part reconnue comme banque centrale par le FMI, la Banque des
Réglements Internationaux, et la World Bank. En plus des postes de dépenses
déjà cités, l'APSA prend en charge les frais des cérémonies, des
conclaves (5 millions de dollars en 1978, pour les élections successives
de Jean-Paul I et Jean-Paul II), des voyages du pape, et de l'entretien de
la diplomatie.
L'administration
de l'Armée Sainte 1983-84 dépendait de l'APSA pour les traitements du
personnel (quatre employés), les publications, etc. Ses cérémonies
d'ouverture et de fermeture furent réglées par le metteur en scène
Zefirelli Le tout pour un budget minime, si l'on considère que le gros du
travail a été déchargé sur des comités spécifiques (un pour chaque
événement : le jubilé des handicapés, des jeunes, des militaires,
etc…) ou locaux déjà existants ou créés pour la circonstance.
D'autre part, le logement des pèlerins a été assuré par des agences de
voyages conventionnées avec des ordres religieux offrant la pension complète
à des prix imbattables (et pour cause : ils disposent d'une main d'oeuvre
gratuite). A ces coûts, il faut ajouter les heures supplémentaires
fournies par les Sampietrini ou les ouvriers de la Fabrique de
Saint-Pierre et l'illumination très coûteuse des basiliques, etc… Là
où le Saint-Siège y a certainement gagné, c'est dans le volume
croissant des offrandes laissées par les pèlerins.
Tandis
que l'infrastructure urbaine indispensable à canaliser le flot humain qui
déferlait sur la cité (une moyenne de 30.000 personnes par jour, avec
une pointe de 100.000 les jours d'audience publique du pape) était
'généreusement'
laissée à charge de la municipalité (communiste) : coût probable
entre 4 et 7 millions de dollars, y compris quelques initiatives
culturelles (coordonnées, cette fois, avec le Vatican). Sans compter avec
les immenses embouteillages quotidiens causés par les autocars et raison
de la nervosité croissante des habitants.
En
somme, le pape continue à disposer, par force d'habitude de Rome comme
d'une propriété privée et pour un investissement contenu a réalisé à
travers l'Armée Sainte une opération promotionnelle d'envergure planétaire
lui permettant, sans se déplacer, de prendre le pouls de toutes les
Eglises du monde et par là même de réaffirmer sa permanence. Le tout en
un grand spectacle qui est autant folklorique que religieux - et donc, très
'vendable'- tandis que la communauté romaine, traditionnellement indifférente
à ce genre de mise en scène, n'en a subi qu'une gêne permanente et
s'est vue obligée d'y engouffrer une partie des taxes qu'elle paie.
Le
patrimoine
Nous
avons déjà mentionné l'importance du patrimoine mobilier du Saint-Siège,
géré par l'APSA Son patrimoine immobilier, bien que lui aussi couvert
par le secret, étant matériel est plus facile à déterminer.
Les
44 hectares proprement dits du Vatican (constitués par des appartements,
les musées, les jardins, et la basilique Saint-Pierre), ainsi que 688.000
m² de terrains construits à usage administratif, plus les universités
pontificales, plus les quelques 40 hectares de la villa d'été du pape à
Castelgandolfo, plus encore 550 hectares d'exploitations agricoles, 200
hectares en bordures de mer et 1.200 hectares en périphérie de Rome,
constituent ce que l'on appelle l'extraterritorialité du Vatican et échappent
à la juridiction italienne. Il n'en va pas de même pour les 325 ordres féminins
(19.812 membres) et les 87 ordres masculins (5.730 membres) représentés
à Rome, avec 600 maisons-mère, 306 paroisses, 30 cloîtres et 1.700
communautés, qui possèdent d'énormes propriétés dont une bonne part
est constituée par des immeubles de rapport. Ces propriétés ne sont pas
- s'en étonnera-t-on ? - recensées comme telles, mais sont enregistrées
auprès du cadastre de l'Etat italien sous les dénominations les plus
diverses comme : chapitres, confraternités, archiconfraternités, congrégations,
vicariats, provinces ecclésiastiques, diocèse, archidiocèse,
basiliques, archibasiliques, secrétariats, hospices, athénées, collèges,
instituts, procures, cures, fondations, sociétés, oeuvres pieuses,
missions, personnes morales gérées par des congrégations, maisons
d'exercices spirituels, conservatoires, séminaires, comités, etc. Une véritable
jungle de noms et prête - noms - car il faut savoir qu'une 'maison
pieuse' n'entre pas dans le même registre qu'une 'pieuse maison'...
Quelques
exemples : le Collège ecclésiastique belge possède un grand immeuble
face au palais présidentiel ; les soeurs de Notre Seigneur de Namur, deux
immeubles pour un total de 43.000 m' dans une zone centrale de la ville ;
tandis que l'Ordre Hospitalier de Saint-Jean détient l'entièreté de l'île
sur le Tibre. Ces propriétés sont dites improductives, et le sont au
moins en partie, puisqu'elles servent à l'exercice des ordres mentionnés
(tout comme les 792 instituts d'éducation et les 325 maisons de
bienfaisance dispersés dans la cité).
Spéculation
Sous
cette réalité en apparence inoffensive, se cache en fait ce qui a été
souvent dénoncé comme le premier empire immobilier de Rome. Selon
certaines estimations, il couvrirait un quart de la superficie de la
capitale et équivaudrait à plusieurs centaines sinon milliers - de
millions de dollars. Car il faut, en plus de ce qui est enregistré,
compter avec les 'fraudes pies' (l'attestation à un prête-nom de biens
de l'Eglise) et les 'fraudes impies' de fait de privés qui, pour échapper
aux taxes italiennes, attestent formellement leurs biens au nom d'un
ordre) dont bénéficient aussi bien laïcs que religieux. Un jungle,
disions-nous, où un terrain peut appartenir à une communauté et la
construction qui y est posée
à un autre. Où la plupart des biens ne sont déclarés que pour une
valeur symbolique et, étant réputés à fin de culte de religion,
d'instruction, d'assistance, d'apostolat, d'évangélisation des infidèles
et de miséricorde, bénéficient d'exemptions fiscales généralisées
(conquises, de droit ou de fait, avec la complicité du pouvoir démocrate-chrétien),
de contributions extraordinaires (censés, décimes du culte, etc…),
d'exemption de la 'main morte' (taxe sur la succession des sociétés), de
subventions communales pour l'entretien des édifices du culte, d'exonération
sur le matériel de construction et sur la valeur ajoutée aux immeubles,
de libertés douanières, du paiement retardé de la TVA, de l'exemption
des taxes professionnelles et même d'aides au 'clergé nécessiteux'.
Pour ne citer que quelques banales facilités. Ce qui permet au Saint-Siège
(toujours, s'entend, sous les dénominations les plus hétéroclites) de
se lancer sans contrôle extérieur dans des opérations de vente et achat
de 'biens pour catéchumènes et novices' avec des banques et sociétés
financières toutes plus ou moins liées au Vatican. Et ce sur la foi
d'expertises qui lui sont, comme par hasard, toujours favorables.
Sans
oublier le système des dévolutions, par lequel sont restitués au
Saint-Siège, à terme déterminé, des biens affectés à des congrégations.
Et les legs exécutés 'en échange du paradis', qui doivent pourtant être
concordés de fois en fois avec le gouvernement italien (ce qui donne une
dimension de l'importance, pour le Vatican, de la collusion avec les
politiciens).
Un
exemple : en 1981, meurt la dame Ines Villa Penna propriétaire de
terrains en Calabre et d'immeubles dans le centre historique de Rome. Elle
laisse l'ensemble à la Compagnie de Jésus, mis à part quelques
appartements destinés à ses plus proches collaborateurs. Les Jésuites
mettent immédiatement en vente fractionnée les immeubles de Rome,
passant outre le testament de la vieille dame qui prévoyait la
'protection de ses chers locataires'. La pratique est inhabituelle : le
droit canon, seul compétent en ce genre d'opérations (à l'exclusion du
droit italien, même si l'opération se déroule sur le territoire de
l'Italie) prévoit que les ordres, pour vendre un bien immobilier, doivent
avancer une raison de bienfaisance. Ce qui peut, parfois, entrer en
contradiction avec l'usage véritable qui est fait du capital. Pour éviter
ce écueil, les ordres procèdent souvent par vente lente, un appartement
par an par exemple, et opposent une fin de non-recevoir à toutes les
protestations de particuliers italiens.
Cette
fois, au contraire, la Compagnie de Jésus démontre la volonté de
conclure l'affaire au plus vite : la raison en est certainement que, afin
de ne pas devoir inclure l'immeuble dans leur patrimoine - et donc de se
trouver après coup dans l'obligation d'en justifier la vente - les jésuites
préfèrent vendre d'abord et intégrer dans leur bilan un capital liquide
qu'ils ne doivent pas déclarer.
Il
s'agit, en quelque sorte, de sauter une étape. La plus importante. A
noter encore que seules les habitations sont mises en vente : la tendance
du Saint-Siège est en effet, depuis une quinzaine d'années, de se débandasser
des locataires désormais trop bien protégés par la loi (italienne) et
ne conserver que les locaux commerciaux de meilleur rapport.
Le
sac de Rome
Ainsi
le Saint-Siège participe-t-il activement à la transformation de la
morphologie de Rome, au "recyclage" de son centre (où il possède
la plupart de ses biens) en bureaux et négoces, repoussant petit à petit
la population vers la périphérie où agissent les spéculateurs
immobiliers dont bon nombre sont étroitement liés au Vatican. Au point
que, dit-on en ville, le Vatican est en train de se livrer au troisième
sac de Rome de premier date de l'antiquité, et fut l’oeuvre des
barbares ; le second fut réalisé par les grandes familles de la
Renaissance, avides de vieux marbres pour leurs palais). Un sac conçu et
réalisé avec la complicité active de sociétés immobilières et
d'assurances, de banques et autres capitalistes attirés par les énormes
richesses du palais de l'Eglise ou directement dépendants d'elles.
Et
encore, ceci ne concerne que Rome. Le même discours peut être fait à
propos de la plupart des villes d'Italie et de tant de cités d'Amérique
du Sud... Ce qui est en parfait contraste, un de plus, avec les dires de
Karol Wojtyla : 'Le Siège Apostolique ne développe et ne peut développer
l'activité économique propre à un Etat ; et exclut de ses finalités
institutionnelles la production de biens économiques et l'enrichissement
par la rente', tandis que l'offrande doit être son seul moyen de
subsistance 'sans recourir à d'autres moyens qui pourraient apparaître
comme moins respectueux de son caractère particulier'. Une affirmation
complètement démentie par ce qui précède et qui n'est pourtant qu'un pâle
croquis des activités immobilières du Saint-Siège.
Non
sans raison l'on commence, dans la chrétienté, à se rendre compte de ce
double jeu. En 1974, le fait était dénoncé lors d'un congrès des
catholiques romains et repris, la même année, par le synode des évêques
qui demandait : 'Les biens de l'Eglise sont-ils toujours administrés
comme le patrimoine des pauvres ? Leur gestion parfois n'induit-elle pas
une accumulation de la richesse identifiant l'Eglise avec les riches et
les puissants, tandis qu'elle réduit sa crédibilité quand elle cherche
à s'élever contre l'injustice et promouvoir la justice ?' La question
posée par le synode - un organe consultatif, donc sans poids réel - est
jusqu'à présent demeurée sans réponse de la part de 'l'accusé'.
Tandis que Ugo Poletti le Vicaire Général de Rome en 1984 exhumait les résultats
du congrès des catholiques pour en retourner le sens : selon lui, les
'maux' de Rome (spéculation immobilière, etc) sont dûs au manque
d'ouverture des institutions communales (à dominante communiste) à
l'offre de collaboration charitable de l'Eglise, et de citer la
disponibilité des 3.000 volontaires de Caritas Catholica. L'Eglise, comme
il a déjà été mentionné, se sert du paravent de la religion pour
masquer ses autres activités.
Faisons
un dernier exemple, digne d'une anthologie : le palais de la Dataria,
toujours au plein centre de Rome, fut cédé par le Vatican à l'agence
APSA pour le ridicule montant des frais de notaire, mais sans pour autant
que l'immeuble historique perde ses privilèges d'extraterritorialité. En
conséquence, l'agence de presse 'officieuse'du gouvernement italien opère
sur un territoire du Vatican. Peut-on rêver mieux comme éventuel moyen
de pression occulte ?...
En
1977, l'hebdomadaire milanais «Europeo» publiait une enquête sur les
exactions immobilières du Saint-Siège. Réaction immédiate de
l'Osservatore Romano : ces articles relèvent d'un anticléricalisme
obtus, ils sont 'anticulturels' (?), irresponsables, et ne visent qu'au
scandale gratuit. Une condamnation qui, pourtant, ne comporte aucun démenti.
Quinze jours plus tard, le directeur de la revue, sous pression de l'éditeur
doublement lié au Vatican, remettait sa démission (à vrai dire, ce
directeur n'avait auparavant pas été tendre avec le monde de la finance
catholique et la politique attenante).
L'argument
principal opposé à l'Europeo par le Saint-Siège était que celui-ci
n'intervient pas dans l'organisation et la gestion des différents ordres
religieux qui, par conséquent, disposent de leurs biens comme bon leur
semble. La chose est peut-être vraie, mais c'est oublier que les
administrateurs de ces biens sont nommés par les évêques, que les évêques
sont contrôlés par les cardinaux, que les cardinaux sont nommés par le
pape qui, d'autre part, se proclame constitutionnellement 'administrateur
et dispensateur' de toutes les richesses ecclésiastiques. C'est oublier
aussi que les ordres, pour réaliser leurs opérations immobilières,
doivent se munir d'une autorisation délivrée par la curie.
Le
patrimoine de l'Eglise apparaît donc comme fractionné et incontrôlable
par l'Eglise elle-même mais pratiquement, puisqu'il dépend de la hiérarchie
ecclésiastique, il est réuni de manière invisible et efficace.
Et
demeure une interrogation : pourquoi le Vatican, tellement spécialisé
dans le "silence pieux", aurait-il daigné intervenir lors de
l'enquête de l'Europeo si celle-ci n'était vraiment qu'un tissu de
mensonges ? Il est vrai que nous nous trouvions alors en pleine époque de
révision du concordat, et que le Saint Siège avait tout intérêt à
apparaître au public comme plus que jamais nécessiteux. Comme il a été
dit, en appendice au "nouveau" concordat ont éte élaborées,
plus ou moins dans les délais prévus, des normes précises en ce qui
concerne le régime des biens de l'Eglise, le statut de son patrimoine
culturel, et le traitement du clergé.
Le
canon 1256 du droit de l'Eglise établit que 'la propriété des biens,
sous la suprême autorité du Pontife Romain, appartient à la personne
juridique (paroisse, diocèse) qui les a légalement acquis'. Et le canon
1276 : "Le Pontife Romain, en vertu de la suprématie de son
gouvernement, est l'administrateur et l'économe suprême de tous les
biens ecclésiastiques. Il y a donc séparation entre propriété et
administration ; la propriété étant régie par le droit canon et/ou le
droit italien, tandis que l'administrateur échappe, vu sa position, à la
loi. Ce qui laisse à nouveau la porte ouverte aux abus dont nous venons
de parier.
D'autre
part, dans cet appendice au concordat, une généreuse confusion entre
'nature' et 'activité' religieuse est maintenue, qui a jusqu'à présent
permis un certain enrichissement des organismes religieux des gains
pouvant être escamotés et aussitôt réinvestis dans d'autres activités)
: un cinéma peut-il ainsi jouir des mêmes exonérations fiscales qu'un hôpital?
Selon les nouvelles normes, 'sont considérés comme ayant une fin
religieuse ou de culte les organismes qui font partie de la constitution
hiérarchique de l'Eglise, les instituts religieux, et les séminaires'.
Pour ceux-là, l'inscription au registre des personnes civiles (de droit
italien) est automatique. Tandis que le Vatican a la faculté de demander
des dispenses pour d'autres organismes 'aux activités connexes à des
finalités de caractère caritatif : la définition est vague, elle rend
possible un élargissement du statut privilégié à toutes les Oeuvres
Pies dont le but lucratif est souvent marqué. Tout dépendra, ici, de la
vigilance dont feront preuve les fonctionnaires et les politiciens chargés
de faire respecter les normes.
L'inscription
au registre des personnes civiles devrait permettre de réaliser un
recensement complet des biens ecclésiastiques réclamé depuis quarante
ans par toutes les forces politiques de l'opposition. Mais il s'agit d'une
supposition théorique, car il manque encore les instruments
administratifs indispensables à l'exécution du projet. Et, au vu d'un siècle
de relations déséquilibrées entre l'Etat laïque et le Saint-Siège,
gageons que le gouvernement de l'Eglise et la Démocratie-chrétienne
sauront, cette fois encore, éviter le 'piège'. Et nous ne parlons ici
que des rapports entre Vatican et Italie, terrain de choix, certes, mais
non terrain unique du renforcement du pouvoir de l'Eglise catholique.
Combien sont en effet les pays à posséder, eux aussi, leur concordat ?
Ce concordat détermine-t-il une situation de respect réciproque ? Que
l'on se souvienne seulement que l'indépendance en Belgique, fut accompagnée
d'une victorieuse offensive des évêques qui assura pour longtemps à
l'Eglise le premier poste dans l'enseignement.
Le
patrimoine culturel
En
plus de ce patrimoine immobilier, le Vatican possède un énorme
patrimoine culturel. Il s'agit, d'abord, de la basilique Saint-Pierre et
de ses annexes, ensemble architectural composite, réalisé par les
meilleurs artistes depuis la Renaissance. Puis, viennent les bâtiments érigés
dans la Cité du Vatican et leurs ornementations (dont la valeur a pu être
estimée au double du budget de l'Etat Italien) et les musées (90.000 m²
y compris les réserves : d'une capacité de 10 à 15.000 visiteurs par
jour, exposant des oeuvres uniques allant de la plus haute antiquité à
l'art moderne). Ce à quoi il faut ajouter les fonds privés prêtés en
permanence au Vatican, la bibliothèque apostolique (qui couvre quatre siècles
d'histoire et est la plus grande du monde), les archives secrètes,
l'observatoire astronomique (construit au XVIème siècle en vue du calcul
de notre calendrier grégorien), deux bunkers à l'épreuve du feu et des
explosions atomiques conservant les manuscrits les plus précieux, et
enfin les oeuvres d'art peuplant les bureaux et logements, résultat du mécénat
systématiquement pratiqué au cours des siècles par les papes et leur
suite.
Ce
patrimoine culturel a été presque entièrement acquis par donations ou
échanges. Ainsi la Belgique put-elle troquer, contre des sculptures de
l'antiquité et à titre de 'prêt permanent', une tapisserie des
Barberini manquante à la collection vaticane.
La
possession du trésor accumulé de la sorte permet au Vatican de contrôler,
indirectement, une partie du marché de l'art : par la simple libération
au juste moment, d'une pièce recherchée, il est en mesure de bouleverser
les prix internationaux. Un médaillon de marbre de la fameuse Pieta de
Michel-Ange a été vendu à Londres, en 1979, pour quelques 20 millions
de livres - ce qui donne une vague idée de la valeur potentielle de
l'original conservé dans le musée du pape.
Le
trésor du Vatican est complété, sur un autre versant, par les réserves
en or tenues à Fort Knox aux USA et en bonne partie résultat du
judicieux transfert de fonds de l'APSA en ce pays à la veille de la
seconde guerre mondiale. Leur estimation se monte à 4 ou 5 milliards de
dollars.
Tout
ceci appartient au pape - à sa fonction, s'entend, et non pas à sa
personne. Et alors Paul VI, dans un geste vers l'Eglise des pauvres"
ne pouvait-il mettre en vente que la tiare qui lui avait été offerte
personnellement par ses fidèles de Milan, un objet de 32 rubis, 19 émeraudes,
Il saphirs, 529 diamants et 252 perles finalement acquis par le cardinal
Spellman de New York.
Pour
la loi italienne, 'les trésors d'art et de science existant dans la Cité
du Vatican et dans les Palais du Latran doivent être visibles aux
chercheurs et aux visiteurs'. Sur la Cité seule (y compris SaintPierre et
la chapelle Sixtine) le pape détient la souveraineté absolue. Tout le
reste fait partie intégrante du patrimoine national, et à ce titre est
placé sous la tutelle de l'Etat. N'empêche que le SaintSiège a fait
transférer d'autorité , le musée paléo-chrétien et une collection
d'antiquités du Latran à l'intérieur du Vatican (et donc en 'territoire
étranger'). N'empêche aussi que la tutelle de l'Italie se limite
effectivement à une 'collaboration'
autrement dit, le Saint Siège décide de la nécessité d'une
restauration à un édifice du culte, et l'Etat italien exécute à ses
frais.
L'annexe
du 'nouveau' concordat, en plus de réaffirmer la validité de la loi
italienne en la matière, a établi le statut du patrimoine artistique et
culturel sous la garde de l'Eglise Italie et Vatican s'y engagent à
coordonner leurs efforts afin de 'concorder les normes de l'entretien, de
la sauvegarde, de la valorisation et de la jouissance des biens culturels
ayant un caractère sacré'. En outre, est prévue la constitution d'un
fonds de 3.500 millions de Lire, géré par le ministère de l'Intérieur
et renouvelable annuellement, destiné à l'entretien et la construction
de nouveaux édifices religieux. Il en résulte une souveraineté mixte
sur une importante partie du patrimoine culturel italien. En d'autres
termes, le Vatican se voit reconnaître un pouvoir normatif en la matière
: ce qui représente un bond en arrière d'un demi-siècle, l'argument
n'ayant pas été considéré par le concordat de 1929.
Aujourd'hui,
aucune personne privée ou juridique ne bénéficie, dans la République,
des largesses qui viennent d'être octroyées à l'Etat du Vatican et au
Saint-Siège.
Largesses
qui, semble-t-il, ne leur suffisent pas encore : en témoigne la grotesque
histoire de l' "enlèvement" du Christ ressucité ou porteur de
croix, une statue sculptée par Michel-Ange en 1520 et exposée dans l'église
de Sainte Marie sur Minerve, au coeur de Rome. En mai 1984, quelques mois
après la ratification du concordat, la précieuse statue était emballée
et prête à être envoyée à la Nouvelle Orléans où elle aurait dû
devenir le clou du pavillon de vres ne pouvait-il mettre en vente
que la tiare qui lui avait été offerte personnellement par ses fidèles
de Milan, un objet de 32 rubis, 19 émeraudes, 11 saphirs, 529 diamants et
252 perles finalement acquis par le cardinal Spellman de New York.
Pour
la loi italienne, 'les trésors d'art et de science existant dans la Cité
du Vatican et dans les Palais du Latran doivent être visibles aux
chercheurs et aux visiteurs'. Sur la Cité seule (y compris SaintPierre et
la chapelle Sixtine) le pape détient la souveraineté absolue. Tout le
reste fait partie intégrante du patrimoine national, et à ce titre est
placé sous la tutelle de l'Etat. N'empêche que le Saint-Siège a fait
transférer d'autorité, le musée paléo-chrétien et une collection
d'antiquités du Latran à l'intérieur du Vatican (et donc en 'territoire
étranger'). N'empêche aussi que la tutelle de l'Italie se limite
effectivement à une 'collaboration' - autrement dit, le Saint Siège décide
de la nécessité d'une restauration à un édifice du culte, et l'Etat
italien exécute à ses frais.
L'annexe
du 'nouveau' concordat, en plus de réaffirmer la validité de la loi
italienne en la matière, a établi le statut du patrimoine artistique et
culturel sous la garde de l'Eglise Italie et Vatican s'y engagent à
coordonner leurs efforts afin de 'concorder les normes de l'entretien, de
la sauvegarde, de la valorisation et de la jouissance des biens culturels
ayant un caractère sacré'. En outre, est prévue la constitution d'un
fonds de 3.500 millions de Lire, géré par le ministère de l'Intérieur
et renouvelable annuellement, destiné à l'entretien et la construction
de nouveaux édifices religieux. Il en résulte une souveraineté mixte
sur une importante partie du patrimoine culturel italien. En d'autres
termes, le Vatican se voit reconnaître un pouvoir normatif en la matière
: ce qui représente un bond en arrière d'un demi-siècle, l'argument
n'ayant pas été considéré par le concordat de 1929.
Aujourd'hui,
aucune personne privée ou juridique ne bénéficie, dans la République,
des largesses qui viennent d'être octroyées à l'Etat du Vatican et au
Saint-Siège.
Largesses
qui, semble-t-il, ne leur suffisent pas encore : en témoigne la grotesque
histoire de l' "enlèvement" du Christ ressuscité ou porteur de
croix, une statue sculptée par Michel-Ange en 1520 et exposée dans l'église
de Sainte Marie sur Minerve, au coeur de Rome. En mai 1984, quelques mois
après la ratification du concordat, la précieuse statue était emballée
et prête à être envoyée à la Nouvelle Orléans où elle aurait dû
devenir le clou du pavillon de l'épiscopat américain dans la Louisiana
World Expo, 'un show de 350 millions de dollars' selon ses organisateurs,
une sorte de Disneyland provisoire dépourvu de toute intention
culturelle. L'escamotage de la statue, éventé au dernier moment et par
hasard, ignorait l'avis contraire des experts, l'autorité de
l'administration des Biens culturels (I'Eglise et son contenu sont de
propriété domaniale) et violait une loi interdisant le transport
d'oeuvres de grande dimension (la statue mesure deux mètres). Avec la
complicité, diton, de deux ministres démocrates-chrétiens. Le Vatican,
bien entendu, déclina toute responsabilité (c'est pourtant lui qui avait
commandité la société de transport) et renvoya à l'épiscopat américain.
Un épiscopat d'autant plus intouchable qu'il est lointain.
Vatican
et Saint-Siège, sautant les accords encore tout frais, utilisent le
patrimoine artistique publique en fonction de leurs propres besoins de
propagande, faisant peser le coût de son entretien à la communauté
nationale italienne.
On
se lamente souvent, au Vatican, du poids financier que représentent le
maintien et la sécurité de ses collections d'art, et l'on omet systématiquement
de mentionner qu'elles constituent, outre la religion, le principal
attrait du Vatican et qu'elles servent mieux que n'importe quel discours
à la promotion de son image de marque.
Denier
de Saint-Pierre et portion congrue
En
dehors des revenus du portefeuille de titres géré par l'APSA et des spéculations
immobilières, le Saint-Siège bénéficie, en tant qu'entrée de capitaux
frais, du Denier de Saint-Pierre récolté une fois par an partout dans le
monde.
Témoin
d'une tradition séculaire, de Denier fut remis à l'honneur après 1870
et connaît actuellement une tendance notable à la baisse : les intérêts
conservateurs du Saint Siège et sa participation dans des opérations économiques
peu 'chrétiennes' ont largement contribué à lui faire perdre de sa crédibilité.
Les fidèles se montrent moins généreux, ce qui pousse le Vatican dans
d'autres opérations encore moins claires, etc. Un inévitable cercle
vicieux, tandis que le Denier continue à être présenté comme l'unique
ressource du pape, laquelle s'élevait, en 1978, à 4 ou 5 millions de
dollars (ces chiffres sont certainement manipulés : nous avons déjà vu,
en parlant du bilan du Vatican, qu'ils ne font que couvrir dollar par
dollar les déficits annoncés et les comptes demeurent ainsi toujours
miraculeusement en équilibre).
Il
y a encore la question de la'pars congrua' ou portion congrue, qui est le
véritable prix payé par l'Etat italien depuis cinquante ans en échange
de la paix religieuse. Héritage des prébendes moyenâgeuses, elle est ce
qui a subsisté de la loi sur les Garanties (1871) refusée par le
Saint-Siège : considérant la logique selon laquelle un prêtre a 'charge
d'âmes', donc remplit une fonction publique, l'Etat lui consent un
subside si ses revenus se situent en-dessous du minimum vital.
En
manipulant le découpage des provinces ecclésiastiques, des diocèses et
des paroisses, la Conférence épiscopale italienne est parvenue à
multiplier le nombre des prêtres dans le besoin. Sur 29.000 ecclésiastiques,
les ayants-droit sont actuellement 25.000. Le calcul de la portion congrue
intègre le rendement des 'bénéfices, (ils sont au nombre de 30.000,
dont 740.000 hectares de fermage en Ombrie, Emilie et Toscane - certains
religieux en tirent de grosses rentes, comme don Lorenzo Pugi prévôt de
San Pietro Mercantale, bénéficiaire d'une des plus rentables entreprises
vinicoles du Chianti). Le minimum vital a été fixé en 1974 : 735.000
Lire pour un curé, 2.960.000 Lires pour un évêque, et 3.150.000 Lires
pour un titulaire de siège métropolitain. En tenant compte de
l'indexation, un curé empoche aujourd'hui un peu moins de 1.000.000 de
Lires, soit l'équivalent du traitement d'un employé. L'ensemble de la
'pars congrua' grève le budget italien de 310 milliards de Lires. Ces
revenus, bien entendu, ignorent les gains non déclarés des prêtres :
offrandes, baptêmes, communions solennelles, mariages, funérailles, etc.
Selon
le 'nouveau' concordat, l'année 1990 marquera la fin du régime de la
portion congrue (qui, cette même année, coûtera 470 milliards de Lires
à l'Etat). A sa place, entreront en fonction trois cents Instituts diocésains
pour le soutien du clergé, dirigés par un Institut central, et chargés
de réunir les anciens 'bénéfices', de les rentabiliser, et d'en
distribuer le fruit. La Conférence épiscopale italienne fixera dès lors
le traitement des religieux. Ces modifications, avant d'être négociées
par le concordat, étaient déjà inscrites dans le nouveau droit canon
(1983) : par conséquent, l'Etat italien s'est trouvé devant un fait
accompli, qu'il ne pouvait qu'accepter désormais, s'autofinançant d'une autre innovation : l'Eglise italienne,
sera. un système de déduction fiscale (2.000.000 de Lires par an) semblable à
celui en vigueur aux Etats Unis et en Allemagne fédérale, assorti de
l'attribution de 0.8 % de l'impôt sur les revenus des personnes
physiques, permettra à chaque contribuable qui en fait la demande
d'attribuer une part de ses revenus à l'Eglise Tandis que les chapelains,
les deux cent mille enseignants de religion, et le patrimoine culturel
demeurent à charge de l'Etat.
Le
nouveau système rendra l'Eglise plus libre face à l'Etat. La gestion en
propre de ses biens de rapports lui conférera une plus grande facilité
de manoeuvre et augmentera la dépendance du prêtre à la hiérarchie
(qui, décidant de ses revenus, contrôlera sa position), tout en
rendant leur lustre aux rapports de vassalité : une autre 'restauration'
qui vaut bien quelques éventuels sacrifices financiers en cette époque
de fronde post-conciliaire.
D'autre
part, la gestion en propre élève à nouveau l'Eglise au rang d'entité
économique indépendante, ce que la législation de 1870 voulait éviter.
Sans compter que les nécessités de l'autofinancenient induirent de la
part du clergé un discours beaucoup plus persuasif, un appel constant à
la responsabilité des fidèles, et donc une plus grande rigidité dans
leur encadrement.
On
fait aussi remarquer que le système de déduction fiscale permettra le
fichage systématique des citoyens en deux catégories : les catholiques
et les non-catholiques. Tandis que la gestion unifiée des Instituts diocésains
entraînera une concentration ultérieure des biens ecclésiastiques qui,
en 1870, avaient été atomisés pour échapper au contrôle de l'Etat. Et
concentration signifie, dans tous les cas, pouvoir.
'Les
biens du peuple de Dieu', comme dit le cardinal Anastasio Ballestrero,
seront plus que jamais monopolisés par une élite entretenant cette
confusion où l'on voit une communauté, l'Eglise soutenue par une autre
communauté (l'Italie) dont elle déclare à tous les effets ne pas faire
partie.
Valeurs
boursières
On
peut affirmer que le Saint-Siège, à travers les siècles et par un lent
et silencieux travail de thésaurisation a su accumuler richesses dont
l'existence exige une gestion adéquate. Mais les pratiques économiques
sont souvent peu morales : et alors, afin de sauvegarder sa réputation,
le Saint-Siège se voit poussé à ne révéler qu'une partie des opérations
qu'il lance et à faire disparaître les autres dans ce qu'il est convenu
d'appeler les 'finances secrètes'.
Le
mode de gestion des richesses, au Vatican comme ailleurs, s'adapte bien évidemment
aux structures économiques du temps et du lieu - actuellement le Saint-Siège
met-il l'accent sur les valeurs boursières, fluides, anonymes et
dissimulables à souhait et qu'il fait manipuler sur le marché par des
intermédiaires de confiance.
La
tendance est à l'élimination de certains titres (pharmacie, armement,
cinéma) jugés 'indécents', de la participation dans les sociétés
immobilières, et à la concentration sur les 'utilités' (produits
chimiques, assurances, banques, etc). Le Vatican cherche aussi à désinvestir
en Italie, vu le cours défavorable de la Lire, au profit de l'étranger
(ce qui correspond, entre autres, à l'internationalisation de l'Eglise)
en visant partout à des participations minoritaires pour éviter tant
risques que critiques.
Ces
opérations sont, comme nous allons le voir, en majeure partie réalisées
par l'Institut pour les Oeuvres de Religion (IOR) en étroite relation avec
les paradis fiscaux des Bahamas, du Lichtenstein ou du Luxembourg, et
l'industrie et la finance catholiques du monde entier.
La
politique économique du Vatican trouve son origine dans les changements
socio-politiques du début de notre siècle : le pape venait juste de
perdre les 1.300 km2 de ses territoires qui divisaient la péninsule
italienne d'Est en Ouest, empêchant matériellement son unification
(laquelle n'était intervenue, pour la première fois depuis le Moyen-Age,
qu'en l'année 1870). Une perte qui n'était qu'en partie compensée par
les ressources du Denier de Saint-Pierre, alors que la nouvelle
bourgeoisie accédant au pouvoir se montrait indifférente sinon hostile
à l'Eglise. Le Nord du pays commençait à s'industrialiser. Une première
tentative de concentration capitaliste avait tourné court : les frères
Jacobs 'fervents catholiques proches du parti chrétien belge' et propriétaires
de la Banque vait qu'enregistrer l'état de fait. Le Vatican, afin de
mieux monopoliser l'expansion urbaine, s'assura encore le contrôle des
services publiques : tramways, eau, gaz, électricité.
Cette
fois, le Saint-Père était lancé dans le monde de la haute finance. C'était
le temps de Léon XIII qui réforma et centralisa l'administration économique
du Vatican et créa une caisse secrète qui allait, plus tard, devenir le
IOR. Léon XIII devait se heurter de front au gouvernement belge du Frère
Orban franc-maçon et radical, ayant en 1880 laïcisé l'enseignement. Un
acte qui détermina une interruption de quatre ans dans les relations
diplomatiques entre le Vatican et la Belgique, sans pourtant que le problème
fut réglé (l'on se souviendra de la guerre scolaire', combattue au nom
de principes similaires à la fin des années '50).
Afin
de mieux pénétrer dans la spéculation immobilière, le Vatican se munit
d'une part de la Societa Generale Immobiliare (que nous retrouverons plus
loin) et entre en affaires avec l'Union Générale, une banque française
qui, après une escroquerie aux dommages du Saint-Siège, tombera en
faillite (en cela, dit-on, "aidée" par les Rothschild). Echaudé
le Vatican se replie alors sur le Banco di Roma un nouvel organisme
financier il assure tout de suite la moitié du capital, et commence une
politique de concentration des moulins et fabriques de pâtes. Ce qui lui
permettra, plus tard, de contrôler le prix du pain à Rome.
La
caution morale et idéologique de ces opérations est fournie par
l'encyclique Rerum Novarum oeuvre de Léon XIII par lequel celui-ci s'élève
contre le monopole des luttes sociales par la gauche et rappelle à
l'ordre le clergé progressiste dont les idées risquent de se répandre
comme une traînée de poudre dans les colonies et les régimes
absolutistes bien vus par le Saint Siège. La condamnation de la 'nouvelle
hérésie de l'Eglise du
Nicaragua par Joseph Ratzinger, et dont il a déjà été question, relève
de cette même philosophie.
Ceci,
pour justifier la lutte féroce que les financiers mandatés par le
Vatican livrent en ce début du siècle aux opérateurs économiques laïques.
Rerum Novarum s'étend parallèlement sur quelques thèmes politiques - le
salaire est un droit des travailleurs et non pas une marchandise ;
corporatisme et ouvriérisme de droite sont les meilleures formes de défense
de ces travailleurs ; l'Eglise veille à la justice et défend les
pauvres.
Le
contenu du manifeste navigue à égale distance entre le conservatisme et
le modernisme. C'est sur lui que s'appuyeront les catholiques du Nord de
l'Italie pour fonder leurs coopératives agricoles et leurs instituts de
crédits encore aujourd'hui en activité. Il servira encore de base à la
constitution du premier parti politique de la péninsule, le Partito
Popolare qui, après l'éclipse du fascisme, deviendra la Démocratie Chrétienne
pour continuer la politique vaticane de l'opposition entre Nord et Sud de
la péninsule, entre libéraux et catholiques
selon le vieil adage 'diviser pour régner'qui lui permet de
demeurer majoritaire au Parlement (on notera que le 'non expedit' ou
interdiction de vote imposée aux catholiques ne sera levé qu'au début
de notre siècle -quand, justement, le Saint-Siège se sera doté d'une
structure politique efficace à travers le Partito Popolare et que plus tard les facilités économiques consenties par
le régime fasciste (premier concordat) le mettront en mesure de financer
la future Démocratie-chrétienne).
La
première spéculation immobilière à Rome n'est qu'un feu de paille : la
débâcle survient brutalement en 1887. Les organismes financiers avaient
périlleusement construit un édifice de lettres de change se garantissant
l'une l'autre et les banques étrangères, alarmées, demandent des
comptes. Les faillites se suivent et se ressemblent (en un an, 229 des 407
chantiers de construction seront abandonnés). Les titres de la Generale
Immobiliare s'effondrent. Mais qu'importe : par l'entremise d'hommes
politiques de confiance, le Vatican obtient une généreuse intervention
de l'Etat redresse sa
situation, et l'Immobiliare qui l'a échappé belle se retrouve au début
du siècle nouveau à faire la pluie et le beau temps dans le milieu de la
construction.
Petit
à petit les francs-maçons, ces anticléricaux viscéraux, abaissent pour
leur part la garde : le Saint-Siège s'est désormais constitué en un
solide consortium capitaliste et la bourgeoisie libérale, à l'esprit
toujours pratique, trouve en lui un allié objectif. L'urgence de
l'entente est dictée par l'avènement d'un ennemi commun . le prolétariat
urbain, rouge et athée, contre lequel bourgeoisie et Eglise vont tout
faire pour dresser les paysans catholiques.
Un
des grands opérateurs économiques de la conversion du Saint-Siège en
entité capitaliste fut Ernesto Pacelli. Issu d'une famille de
fonctionnaires du Vatican, neveu de cardinal, cousin germain du futur Pie
XII, il devient conseiller financier du pape à 33 ans, en 1891 (l'armée
même de la rédaction de Rerum Novarum et président de la Banco di Roma
en 1903. Spécialiste des manoeuvres en coulisses, il sut placer les
capitaux du pape dans des positions-clé de l'économie italienne et
internationale. Une de ses fameuses opérations, qui devait faire école,
est celle de l'augmentation du capital de la Banco di Roma : il se livre
d'abord à une réduction de la moitié de la valeur des actions mises en
circulation puis, après quelques passages dans les livres de comptes, émet
de nouveaux titres qu'il 'vend' au pape en échange d'une hypothèque sur
des immeubles pontificaux, Le fait que ces actions soient dans les mains
du souverain pontife en augmente la valeur spéculative. Il ne reste alors
à Pacelli qu'à les mettre sur le marché en réalisant de forts bénéfices.
Seuls n'avoir pas été prévenus de la complexité de la maneuvre, les
petits actionnaires feront les frais de la réduction initiale du capital.
Ernesto
Pacelli lança par la suite les tentacules de la Banco di Roma en France,
au Portugal, en Espagne, et perfectionna la technique des 'fraudes pies'
en réponse aux lois italiennes interdisant à l'Eglise de posséder
certains biens (et qui s'inverseront en 'fraudes impies' quand l'Etat
fasciste, en 1929, restituera ce droit au Vatican) .
Pacelli
devait perdre tout crédit - au Vatican comme au-dehors lors de l'affaire
de la Lybie. Il avait favorisé les investissements de la Banco di Roma
dans cette région alors partie de l'empire ottoman et où les Italiens,
sous la bannière d'une 'pénétration pacifique', s'occupaient avant tout
de prospection minière. Mais les profits tirés de ces activités
semblaient trop bas à Pacelli qui voulait mettre directement la main sur
les richesses du pays. Il finança donc une campagne de presse destinée
à 'provoquer l'événement' et à raidir le gouvernement italien dans son
opposition à l'empire
ottoman. Tant et si bien qu'une guerre fut réellement déclarée : connue
sous le nom 'd'expédition de Lybie', elle dura une année (jusqu'en
octobre 1912) et se voulut une imitation de la politique coloniale des
grandes puissances, une 'nouvelle terre sainte', et 'la croisade du XXème
siècle contre les infidèles'. L'ivresse ainsi exprimée par
l'Osservatore Romano dura peu. Les belligérants concurrent une semi-débacle
réciproque et les alliés de l'Italie, qui n'étaient pas encore prêts
à entrer dans la première guerre mondiale, la forcèrent à verser des réparations
aux Turcs. L'Etat dût encore prendre en charge la majeure partie des
pertes de la Banco di Roma, donc du Vatican, qui s'était poussé en première
ligne (se permettant, entre autres, de spéculer sur les fournitures aux
armées et, sur le prix des chameaux).
La
peu glorieuse initiative sonnait le glas de la participation majoritaire
du Saint-Siège dans l'organisme financier. Il liquidait ses actions et
Ernesto Pacelli était contraint de se retirer. Ce qui ne signifie certes
pas que le Vatican abandonnait la place nanciere : aujourd'hui encore,
tous les dirigeants de la Banco di Roma sont étroitement liés à la Démocratie
Chrétienne et servent, à quelque distance, les intérêts du pape.
Sautons
un demi-siècle d'histoire : rien à dire de la période du fascisme, si
ce n'est qu'après une brève période d'anticléricalisme, Mussolini prêta
à Pie XI, puis à Pie XII, un appui en tous points rendu. Car fascisme et
Eglise avaient en commun l'éternel ennemi (la 'subversion rouge'), l'idéologie
(ordre et discipline, hiérarchie et main de fer pour 'moraliser la
nation') et la doctrine sociale de corporatisme). Le premier concordat, résultat
de ce rapprochement, fut étendu à toutes sortes de privilèges de fait
par une interprétation immanquablement favorable au Saint-Siège - des
privilèges durs à mourir, puisque maintenant encore ils déterminent la
capacité du Saint-Siège d'agir à Rome et autre part (notamment dans le
domaine immobilier, cela a été dit) comme s'il possédait toujours la
souveraineté absolue sur le territoire et les sujets.
Durant
les années cinquante, l'Italie se relevait lentement de ses blessures
avec l'aide des capitaux étrangers qui commençaient à y affluer. La Démocratie
Chrétienne, nouveau parti du pouvoir, allait servir de'bras séculaire'
à l'Eglise en confirmant ses privilèges - non sans quelques incongruités
: le statut de prince du sang et la ‘personnalité sacrée et
inviolable', niés à l'ex-famille régnante, sont accordés par la République
respectivement aux cardinaux et au pape. D'ailleurs, un dicton ne
disait-il pas que, du fascisme et de l'Eglise, seule l'Eglise avait
quelque chance de survivre ?
Dans
le domaine de l'immobilier, c'est le temps de l'argent facile, des
capitaux à fonds perdus déversés sur l'Europe occidentale par le Plan
Marshall et assortis d'une seule condition : qu'ils servent à faire front
à l'avance du communisme. Une lutte, celle-là, très sensible en Italie
et qui a toujours eu le Vatican en première ligne. Ce qui le désigne
comme bénéficiaire prioritaire des largesses américaines.
La
Societa Generale immobiliare, plus que jamais active, monopolise le marché
direct et indirect des terrains et des immeubles. Elle dirige l'expansion
de la métropole vers la périphérie : sur ce qui furent les 'bénéfices'
concédés aux familles de la noblesse 'noire', et qui depuis 1870 sont
devenus les propriétés privées de ces mêmes familles, elle constitue
des consortiums, projette des cotisations achète 10 ce qu'elle revend
1.000, et fait pousser des cités dortoirs (aujourd'hui encore dépourvues
de tout service).
La
Commune, dirigée par la Démocratie-chrétienne, trace les rou et délivre
les autorisations. z Le procès verbal d'un conseil d'administration de
l'Immobiliare énonce : "Dans l'avenir, la Commune de Rome devra se
montrer compréhensive à l'égard de l'Immobiliare, la laissant appliquer
le plan régulateur comme elle l'entend. L'Immobiliare possède les moyens
(architectes, techniciens, urbanistes, etc…) aptes à conférer à Rome
le développement qui convient à une cité de sa tradition." La leçon
est écoutée. Les affaires vont bon train. Rome a été, soit, consignée
à l'Italie naissante qui a eu l'outrecuidance d'en faire sa capitale.
Mais elle a été par la suite - et est encore - saccagée par les bons
soins du Vatican, au nom sans doute d'une trouble vengeance. Et au nom du
profit.
Michele
Sindona
Une
autre histoire de pouvoir : celle de Michèle Sindona . Quand il
entre en scène, à la fin des années soixante, le Vatican connaît un
manque chronique de liquidité. l'APSA a dû se résoudre à diminuer ses
subventions à la presse catholique. L'Eglise s'élargit, et elle a besoin
de moderniser ses moyens de communication, sa propagande. Elle doit faire
face aux (timides) revendications salariales de son personnel laïque. Les
multinationales grignotent son espace d'action financière. Tout cela coûte
à qui ne sait s'adapter. De
plus, l'Etat italien a, en 1968, réintroduit par surprise l'impôt sur
les dividendes du portefeuille de titres possédé par e Saint-Siège (son
exemption était un de ces privilèges acquis sous le fascisme). Paul VI,
le pape d'alors, cherche à diversifier et à exporter les
investissements. Une décision s'impose : pour transformer son entreprise
selon les critères du néo-capitalisme, il doit faire appel à des
financiers laïques rompus aux techniques de la bourse et de la finance
internationales.
Michel
Sindona sera ce premier technicien. Avocat, né en 1914 en Sicile,
transposé à Milan à la fin des années '40, de banquier il se fait
conseiller fiscal et s'occupe ensuite de vente de sociétés, ce qui lui
permet de prendre le contrôle d'une banque de crédit, la Privata
Finanziara En 1958, par un parent proche de la curie, il entre en contact
avec Massimo Spada alors secrétaire de l'APSA et encore aujourd'hui
conseiller de nombreuses sociétés, dont la Banco di Roma Spada grand
bourgeois de tradition, écoute le "génie de la finance"
Sindona qui lui propose de pourvoir à la vente de la Genrale Immobiliare
(elle était entrée en possession de l'immeuble du Watergate à
Washington et de l'Hôtel Meurisse à Paris).
Un
accord est conclu en 1969 entre Spada et Sindona avec lequel il est
d'autre part entré en affaires et dont les propriétés s'étendent désormais
jusqu'aux USA. Massimo Spada est entretemps devenu gentilhomme de Sa
Sainteté, une fonction honorifique qui survit au glorieux passé de la
cour du pape roi et est incluse dans le rôle de la Famille Pontificale.
Sindona s'engage formellement comme intermédiaire, puis comme acquéreur
dans l'opération sur l'Immobiliare les émailleries Genovesi les céramiques
Pozzi (en faillite), et sur la Condotte d'Acqua (qui assure une bonne
partie de la distribution d'eau dans la capitale). Toutes ces sociétés
sont bien entendu propriété du Vatican. Massimo Spada prudemment, délègue
sa signature au prélat Sergio Guerri responsable de l'APSA
Malgré
un premier paiement, l'accord est bientôt conteste : par Giovoanni
Benelli d'abord, le substitut du Secrétaire d'Etat et par Giuseppe Caprio
successeur de Guerri (passé au Governatorato à la tête de l'Apsa.
Caprio élève des doutes quant à la 'solidité' de Sindona - lequel
cherche et trouve un nouvel appui en la personne de l'archevêque Paul
Marcinkus
I.O.R.
Marcinkus
d'origine lituanienne, s'est formé à la diplomatie vaticane après une
rapide ascension dans l'Eglise américaine. L' amitié qu'il lia avec
l'abbé Pasquale Macchi secrétaire particulier du pape, lui permit
d'entrer dans la finance du Saint-Siège et de prendre le relais, dès
1971, du cardinal De Jorrio grand comptable à l'ancienne manière (avec
un penchant marqué pour les mauvais investissements). L'entregent de
Marcinkus lui vaut aussi, un temps, de s'occuper de l'organisation des
voyages du pape (tâche maintenant confiée à Robert Tucci le directeur
de la radio vaticane.
Au
départ Marcinkus qui n'y connaissait pas grand-chose en économie, se
montre avide des conseils dispensés par le 'génie' Sindona. Avec
celui-ci, il comprit vite que le pape avait besoin d'un instrument
financier exclusif et efficace, capable de fournir au Saint-Siège la
liquidité dont l'Eglise universelle avait un urgent besoin. Cet
instrument sera le IOR à la direction duquel Marcinkus parvint sans
encombre.
L'institut
des Oeuvres de Religion, fondé en 1942 pour englober les finances secrètes
héritées de Léon XIII est une société de droit canon (et à ce titre,
elle échappe à la législation italienne) qui gère les dépôts 'destinés
aux oeuvres de religion et de piété chrétienne et, en fait, visant à
fuir tout contrôle indiscret. Une dissimulation pieuse et fort rentable
protège l'Institut : officiellement, il s'occupe des comptes courants du
pape et d'autres honorables déposants ; réalité, il est le canal de
toutes les opérations inavouables du Vatican et de qui, en Italie (la
banque s'active sur le territoire du Vatican, avec une porte généreusement
ouverte sur le territoire italien), désire mettre son argent à l'abri.
Rien qui ressemble à une caisse d'Epargne normale : quelques guichets
anonymes dans la Cité, un hallebardier à l'entrée, une quinzaine de
comptables contraints au secret d'Etat et rigoureusement exclus du
syndicat des employés, une atmosphère feutrée où viennent susurrer
leurs confidences les représentants d'ordres religieux du monde entier ,
des comptes attestés à la 'Divine Providence', au "Sacré-Coeur de
Jésus', etc. Et pourtant, le IOR est un des instituts financiers réputés
les plus solides et solvables. Une banque à propos de laquelle Marcinkus
se lamentait : 'On parle souvent de nos pertes, jamais de nos gains' - et
pour cause puisque ces gains, et simplement le capital réel de l'Institut
sont un des secrets les mieux gardés du Vatican, et que ne parvient au
public que l'écho de quelques unes de ses opérations manquées ou
franchement malhonnêtes.
C'est
alors, notamment, que Sindona vendit à la Sofina belge une société mal
en point. L'affaire fut un désastre, et la Sofina réussit, après
recours, à récupérer une partie de sa mise.
En
résumé, à la fin des années Soixante le couple Sindona Marcinkus file
du bon coton : pour Marcinkus, Sindona représente la possibilité d'une
ouverture sur le marché financier international. Pour Sindona, Marcinkus
possède la clé d'un paradis fiscal installé au milieu de Rome. Dans
l'optique d'un homme d'affaires, c'est un rêve ! Même si Marcinkus, plus
tard, le niera, il est certain que les deux vivent une 'lune de miel' émaillée
de quelques faits saillants (des 'preuves de fidélité' ?) comme le règlement
du contentieux opposant la famille Feltrinelli au Vatican.
Les
Feltrinelli, enrichis d'abord dans le commerce du bois de construction
avaient su diversifier leurs activités et créer un véritable empire
immobilier dont Giangiacomo, le rejeton, touchait les dividendes pour les
investir d'abord dans une maison d'édition et ensuite dans des
entreprises beaucoup moins légales. Giangiacomo Feltrinelli cas typique
du transformisme de la bourgeoisie aisée, fréquenta les révolutionnaires
castristes et les bandes sardes à michemin entre la délinquance et le
terrorisme, et fonda les Groupes d'Action Partisane, vague préfiguration
des Brigades Rouges financés,
cela va de soi, en pompant avec désinvolture dans le patrimoine de la
famille (il mourra, en 1972, au pied d'un pilone à haute tension qu'il
voulait miner détail macabre : le pilone en question se situe sur un
terrain appartenant aux Feltrinnelli ... ). Le fait est qu'en 1965-67, ces
choses commençaient à se savoir et que le Vatican, contrôlant la Banca
Unione avec les Feltrinelli n'avait aucune envie de se trouver mêlé, de
près ou de loin, aux aventures du fils prodigue - mais n'avait pas non
plus intérêt à se débarasser de sa part dans la Banca Unione Ne
restait alors qu'à "débarquer" les Feltrinelli ce que Sindona,
en rachetant les actions de la famille, réalisa en douceur en 1968.
Le
IOR avec son réseau de correspondants couvrant toute l'Italie, avait
aussi servi au Saint-Siège à faire passer, lors de la Libération, des
fonds américains du Sud déjà libéré au Nord du pays, et destinés à
aider les juifs et opposants du régime réfugiés dans les énormes fonds
qui, sortis d'Italie par l'intermédiaire du IOR vont aller alimenter un
vertigineux circuit de sociétés plus ou moins fictives s'achetant et se
garantissant l'une l'autre. Et qui réalisent, par la spéculation sur le
dollar, des gains impensables.
Au
Vatican, où l'argent ne cesse d'affluer, on ferme un oeuil sur les irrégularités
commises. C'est aussi à cette époque que Sindona introduit Roberto Calvi
auprès des cardinaux. Calvi, comme on le sait, est le futur président de
la Banco Ambrosiano qui reprendra les affaires de Sindona. Il finira pendu
à Londres en 1982.
Sindona
aux Amériques
L'italie
commence à être trop petite pour les appétits de Michele Sindona Il se
transfert aux USA où, toujours secondé par Marcin il achète la Franklin
National Bank pour la somme de 40 millions de dollars. L'un des intermédiaires
de l'affaire est Alberto Ferrari, membre de la loge maçonnique P2 et président,
entre autres, d'une société financière qui atteindra la 'notoriété'
en 1978 pour avoir servi de canal à la disparition de 17 millions de
dollars, pot-de-vin officiel de l'Italie dans la conclusion d'un contrat pétrolier
avec l'Arabie Saoudite.
La
tentative de Sindona de prendre une participation dans l'American Vetco
Industries est entachée de telles irrégularités qu'elle vaudra au IOR
de payer une amende de 320.000 dollars au gouvernement américain. Mais
qu'à cela ne tienne : l'ascension de Sindona se fait irrésistible. La
presse le porte aux nues. Il contrôle maintenant 140 sociétés. Pour
renforcer son château de cartes, il joue sur la confiance dont il bénéficie
dans les milieux financiers et multiplie les comptes en banque aux Bahamas
et au Luxembourg, les double de mandats fiduciaires réservés, et y fait
apparaître et disparaître les capitaux qui lui servent dans ses opérations
croisées. Même technique en bourse : avec l'aide de complicités dûment
payées, il vend et achète des actions de ses sociétés dont la valeur réelle
est nulle. Le système est à vitesse de rotation croissante : il ne
produit de richesse que si les transactions se multiplient et s'escamotent
l'une l'autre. Et il s'écroule sur lui-même s'il n'est pas en permanence
réalimenté par de l'argent frais - que Sindona se procure par l'intermédiaire
de ses contacts politiques (démocrates-chrétiens avant tout) et ses
amitiés vaticanes. Car le IOR se trouve ponctuellement derrière chaque
opération de Sindona, soit comme garant, soit comme pourvoyeur de
capitaux.
La
parabole tracée par Michele Sindona dans le firmament de la haute finance
laisse entrevoir la quantité de pouvoir objectif possédé par le Vatican
non pas, bien sûr, que Sindona soit à considérer comme une victime,
depuis longtemps avait-il montré des dispositions pour les affaires peu
claires - mais en confiant son argent à un homme d'affaires spécialisé
dans la spéculation, le Vatican contribue à créer chez cet homme une
'ivresse de l'altitude' ayant un effet explosif dans l'édifice bancaire
international, précaire par nature. Depuis l'échec de l' 'expédition de
Lybie le pape et ses conseillers écclésiastiqes n'ignorent pas le
risque. Ils ont appris à se retirer à temps. l' Eglise des pauvres' se
sert du financier le plus habile, et quand celui-ci perd de son habileté,
il est désavoué au profit d'un personnage nouveau' les prétendants
n'ont jamais manqué.
Sindona,
qui n'est pas lui non plus né de la dernière pluie, tente de protéger
ses arrières en diversifiant ses sources d'approvisionnement. Il propose
à la Cosa Nostra, la mafia américaine (n'oublions pas que Sindona est
sicilien) de très lucratifs investissements. Plutôt que de placer, à
grands frais, les bénéfices de ses trafics sur des comptes numérotés
en Suisse, la Cosa Nostra en confie une partie à Sindona qui l'insuffle dans
son circuit de sociétés-bidon. Pour le banquier, un capital en vaut un
autre, pourvu qu'il soit incontrôlable et incontrôlé, et à cet égard,
l'argent de la drogue n'a d'égal que celui du Vatican.
Ce
dernier contrat avec la Cosa Nostra porte Sindona au sommet absolu et tant
convoité. Erreur fatale : quand l'information commence à filtrer,
politiciens et écclésiastioques s'empressent de retirer leur appui au
financier. La Franklin, mise sous enquête, est bientôt déclarée en
faillite frauduleuse pour une perte de 40 millions de dollars sur de
mauvaises opérations de change. Sindona tente un redressement, mais ne
parvient pas à se débarrasser à temps de l'Immobiliare ni ne réussit
quelques unes de ces fusions dont il a le tous malgré l'aide du Banco di
Roma (ce qui vaudra à son directeur, plus tard, d'être arrêté pour
complicité et occultation de preuves). Tandis que le krach gagne, une à
une, toutes les sociétés de l'empire sindonien Conseillé par Licio
Gelmli le banquier se retire quelques temps à Taïwan Il est déjà trop
tard : le IOR prend ses distances et refuse, brandissant la Raison d'Etat
de reconnaître son implication dans les ‘aventures de Sindona’ comme
dit Marcinkus (ce qui n'empêchera pas le IOR de récupérer au plus vite
5 millions de dollars dans les caisses à double fond du banquier,
ignorant l'interdiction dont elles font désormais l'objet).
Le
juge Guidi Viola a écrit : 'L'appui au plan de sauvetage (proposé par
Sindona) une véritable escroquerie à charge de la Banca d'Italia et de
la communauté nationale, était fourni par de hautes personnalités
politiques, en premier lieu par le premier ministre de l'époque, Giulio
Andreotti.' Andreotti, comme nous le savons, est démocrate-chrétien. Le
plan de Sindona portait-sur 156 millions de dollars.
Mario
Sarcinelli et Paolo Baffi respectivement sous-directeur et gouverneur de
la Banca d'Italia, s'étant opposés à la manœuvre furent poursuivis et
arrêtés pour 'abus professionnels', après une campagne de diffamation
menée par Licio Gelli Le juge qui instruit le cas est Antonio Alibrandi,
père de Alessandro, un terroriste néo-fasciste abattu par la police en
1981, et lui-même plusieurs fois cité lors de procès de terrorisme. Ce
qui ne l'empêcha pas de devenir, en 1984, Conseiller en Cassation.
La
Societa Generale immobiliare devenue Immobiliare-Sogene, fut rachetée en
1974 à Sindonia par Arcangelo Belli, l'un des survivants des spéculateurs
immobiliers liés au Vatican. L'entreprise, à la dérive, ne pouvait être
sauvée même après l'intervention de Giulio Andreotti, alors ministre du
Bilan. Avec ses 81 millions de dollars de dette, elle était consignée à
ses créditeurs : la Banco di Roma la Banco di Santo Spirito la Nuovo
Banco Ambrosiano la San Paolmo etc. Tous organismes dépendants Vatican.
La boucle est bouclée : la société a assuré, un siècle durant, d'énormes
bénéfices au Saint-Siège - et peu importe les pertes qui devront être
assumées par quelqu'un (l'Etat), pour autant que l'ensemble de la
manoeuvre permette au Vatican de demeurer dans le circuit de la finance.
Retournons
à Sindona : nous sommes en 1976. Le financier est condamné une première
fois en Italie à trois ans de réclusion pour violation des règlements
bancaires. Giulio Andreotti alors premier ministre, intervient plusieurs
fois en la faveur du banqueroutier victime, selon lui, d'un 'complot'.
Mais sans résultat. Sindona des USA, cherche à renouer ses liens avec la
franc-maçonnerie et la mafia - avec un certain succès, semble-t-il,
puisqu'il peut en 1979 faire éliminer physiquement un liquidateur italien
trop curieux de ses affaires par un tueur lié à la Cosa Nostra Coût de
l'opération : 45.000 dollars.
Puis
il met en scène une campagne diffamatoire et fait chanter Roberto Calvi.
Pour cela, il utilise les services de Luigi Cavallo agitateur notoire de
droite lié à la franc-maçonnerie et à l'appareil de renseignement
italien (il sera arrêté en France en 1984), et aussi la médiation de
Licio Gelli Rendement de l'opération : 500.000 dollars. La famille
Gambino (versée dans le trafic de la drogue) lui organise aussi un faux
enlèvement rocambolesque qui le conduit, sous le nom de Joseph Bonami de
New York à Palerme en passant par Athènes et Vienne. A Palerme, il est
protégé - ou surveillé ? - par la famille Inzirello-Spatola (riche,
outre ses revenus illicites, en solides appuis politiques), par certains
éléments de la loge P2 et par une autre association maçonnique tout
aussi "couverte" que la première. N'ayant pas pu réunir les
fonds que, vraisemblablement, il devait à la mafia, Sindona est contraint
de refaire surface aux USA où il est condamné en 1980 à 25 ans de
prison pour la faillite de la Franklin.
Dans
une tentative de se disculper, Sindona racontera aux enquêteurs américains
une fort intéressante histoire : le but de son voyage en Sicile aurait été
d'unifier les forces indépendantistes de l'île. Pour comprendre le
concept, nous devons remonter à la Libération, et plus précisément au
massacre de Portella della Ginestra (1er mai 1947) où Salvatore Giuliano,
bandit mafiosi, fit ouvrir le feu sur les travailleurs manifestants.
L'enquête ne découvrit jamais les mandants de l'expédition, mais détermina
l'existence d'une alliance visant à faire de la Sicile, une fois détachée
de l'Italie. une dépendance des Etats Unis - une alliance où se trouve
la mafia (bien implantée aux Etats-Unis et en Sicile, et en passe de développer
ses trafics), les politiciens et franges des services secrets les plus
conservateurs, liés au clergé et à la noblesse, et les francs-maçons.
Parmi ces derniers, la loge Alam du prince Giovanni Francesco Alliata di
Monterela (par la suite impliqué dans au moins deux complots italiens).
Le lien entre ces milieux étant assuré par Frank Gigliotti pasteur,
franc-maçon et agent de l'Oss (ancêtre de la CIA) Lequel, dans les années
Soixante, réalisera l'unification du Grand Orient d'Italie, aujourd'hui
encore en contact avec la CIA, et, se servant de la loge de Alliata,
fondera la loge P2 qu'il confiera personnellement à Licio Gelli en 1971
(Gelli avait collaboré, entre autres, avec l'Oss) Le dénominateur commun
de ces personnages est l'anticommunisme viscéral.
Ce
n'est donc pas par hasard que, durant sa permanence en Sicile, Sindona se
targuera de l'aide de Joseph Miceli Crimi, médecin et franc-maçon émigré
aux Etats Unis, chargé par lui des médiations avec le monde politique et
Licio Gelli.
La
réalité, en fait, est que peut-être Sindona se sera servi des relents
d'indépendantisme encore présents parmi les conservateurs
Siciliens
pour vernir de 'dignité politique' la nouvelle escroquerie qu'il essayait
de mettre sur pied.
Il
aura fallu attendre 1983 pour que le procès contre la 'bande Sindona'
s'ouvre en Italie. 'La vérité, a dit un juge chargé de l'instruction,
est que l'establishment politico-financier n'avait aucun intérêt à ce
que se tienne ce débat.' Après neuf mois d'audience, la Cour a rendu ses
conclusions, prononçant vingt-deux condamnations pour un total de 122 ans
de prison. Dont celles de Luigi Mennini (gentihomme de Sa Sainteté et
administrateur-délégué du IOR sept ans de détention) et de Massimo
Spada (pour son rôle de représentant du Vatican dans bon nombre de sociétés
de Sindona, cinq ans de détention). Tous deux ont tenté d'opposer à la
sentence leur immunité diplomatique (Paul Marcinkus, Sergio Guerri et
Giuseppe Caprio appelent par la défense dans le procès américain, avais
fait de même), ce qui semble bien avoir porté puisque Massimo Spada se
présentait en septembre 1984, libre, aux obsèques de Carlo Pesenti un
autre financier catholique.
Un
ultime détail : après la mort mystérieuse, lors d'une tentative d'évasion,
de Joseph Arico, le tueur de Cosa Nostra engagé en 1979 par Sindona et
qui peut-être en savait long sur les délits du banquier, celui-ci
exprima le désir de rentrer en Italie. Craignait-il pour sa vie, ou plutôt
la disparition d'un témoin gênant le mettait il à l'abri de nouvelles
surprises ? Son voeu, en tout cas, a été exaucé en septembre 1984. En
Italie, en plus du procès en cours pour banqueroute frauduleuse, il aura
aussi à répondre d'extorsion, d'assassinat, et d'association criminelle
: une longue série de combats légaux qu'il veut transformer en "un
grand cirque" dont on attend encore le spectacle.
Les
'aventures' de Michele Sindona illustrent bien la connivence existant
entre les milieux financiers catholiques, le pouvoir politique, et le
Vatican. Souvent, s'introduit entre ces pôles, et avec une fonction de
lien et de conseil, une centrale de pouvoir occulte ; la loge maçonnique
P2 (aujourd'hui démasquée mais, comme certains indices tendent à le
prouver, loin d'être démantelée). Un de ses représentants les plus intéressants
est sans aucun doute Umberto Ortolani.
Histoires
de P2
Umberto
Ortolani un avocat de 73 ans, arriva très tôt à Rome dans la suite d'un
cardinal de Bologne, et devint en 1963 gentilhomme de Sa Sainteté. Nous
avons déjà parlé de cette charge honorifique, qui permet encore
maintenant à ses bénéficiaires d'entrer dans l'intimité des grands de
l'Eglise Pour un ambitieux comme Ortolani; c'est un poste d'observation -
et d'action de choix.
Au
début des années soixante, il s'est déjà hissé à une place honorable
dans le monde des affaires romain, où il démontre une manie de la presse
et du contrôle de l'information. En 1963, il trafique derrière le rideau
lors de l'élection de Paul VI. Ses 'alliés' sont Giulio Andreotti, le
cardinal Lercaro son protecteur, et le cardinal Sueriens. Ces deux
derniers étant inscrits sur la liste des 'papables' Leo Josef Suenens
fait cardinal peu auparavant sur intervention de la famille royale belge,
renoncera en 1979 à l'archevêché de MalinesBruxelles pour entrer dans
la curie et résider à Rome.
Ortolani
prêtera aussi son généreux concours à Michele Sindona lors de
l'affaire de la Generale Immobiliare et fréquentera Giovanni Leone,
l'unique président de la République italienne obligé de démissionner
pour avoir été mêlé à un scandale politicoo-financier celui de la
Lockheed. Ses premiers contacts avec Licio Gelli fondateur de la P2,
remonte à 1973 : cette année-là, une agence de presse proche de la
franc-maçonnerie (et dont le directeur sera plus tard assassiné) avait
rendu publique un document selon lequel 'les problèmes de l'Argentine' ne
pouvaient être réglés que par l' 'élimination' de Oberdan Sallustro et
Aurelio Peccei dirigeants de la Fiat et des Ortolani père et fils (et de
fait, Sallustro fut enlevé et exécuté dans des circonstances jamais éclaircies
; Peccei fut rapatrié et, jusqu'à sa mort, ne s'occupa plus que du Club
de Rome dont il avait été l'initiateur). Ortolani dont les affaires en
Amérique du Sud commençaient à marcher à plein rendement, prit peur.
Au point de s'adresser à Gelli pour trouver de l'aide, et de s'inscrire
à la P2 malgré le risque, pour le croyant qu'il est, de
l'excommunication attendant tous les Francs-maçons
Il
découvre chez Gelli la même passion de la presse qui l'habite. Il
devient son voisin à Montevideo et, sans dédaigner la collaboration de
Roberto Calvi, renforce sa banque Bafisud étend ses affaires jusqu'au Brésil
et en Suisse, tout en maintenant de solides bases en Italie. Partagé
entre le pouvoir occulte et ses amitiés vaticanes, il devient le
coordinateur, le recruteur et l'éminence grise de la P2. Le 'trio GOC'
(Gelli-Ortolani-Calvi) est désormais affirmé.
Les
alliances politiques ne sont certes pas oubliées : les connaissances
d'Ortolani, outre Giulio Andreotti, ont nom Joseph Strauss de leader
catholique bavarois qui fut reçu par Paul VI, en tant que symbole de la
nouvelle alliance de la droite avec l'Eglise contre la gauche) et
Stroessner, le général dictateur du Paraguay. Ortrolani participe
activement à la mise au point du projet de coup d'Etta du général
Borghese, en Italie - une entreprise qui en 1974, ne fut éventée que
d'extrême justesse. Il s'occupe encore de terrorisme néo-fasciste (et
l'on ne peut ici éviter de signaler la 'coïncidence' entre l'évasion de
Licio Gelli de la prison de Lausanne, en août 1983, et l'attentat manqué
au rapide Milan-Palerme, à quelques kilomètres de l'endroit où advint
la tragédie de l'Italicus - ces deux derniers faits ayant été revendiqués,
à neuf ans d'interval, par Ordine Nero une formation d'extrême-droite
dont se servaient Gelli et Ortolani).
Trafics
Ortolani
est aussi le superviseur d'une colossale série de trafics sur les pétroles
qui coûta aux finances de l'État italien, entre 1972 et 1978, plus d'un
milliard de dollars de manque à gagner et valut à 42 personnes d'être
renvoyées en jugement. Ce sont des fonctionnaires des Finances (comme le
général Giudice), des hommes d'affaires ex-collègues des premiers, et
des prêtres (Simeone Duca, ancien collaborateur de la Congrégation
Propaganda Fide et de monseigneur Paul Marcinkus, puissant prélat romain
aux solides relations mondaines, et rendu celèbre pour avoir versé comme
caution à sa liberté un milliard de Lires ; Francesco Quaglia, curé de
Cesano (Novara), doté de moyens financiers que ne justifie pas sa modeste
condition de prêtre de campagne) passés aux affaires et assurant la
bienveillance de politiciens en majorité démocrateschrétiens (où l'on
rencontre Sereno Freati secrétaire d'Aldo Moro et récipiendaire d'une
'mensualité' des trafiquants destinée à financer le parti de son patron
- tandis que Giulio Andreotti, alors ministre de la Défense, signa la
nomination du général Giudice).
Exception
faite d'Andreotti et de Ugo Poletti de Vicaire Général de Rome, ardent
partisan de Giudice en faveur duquel il multiplia les recommandations, et
en étroite relation avec don Quaglia ainsi que d'Ortolani tout ce beau
monde fut finalement accusé et jeté en prison - d'où, petit à petit,
il sort pour "raison de santé".
L'épisode
est significatif : il montre des escrocs (capables de transformer
miraculeusement, dans leurs comptes, l'essence en 'eau de lavage')
chercher (et trouver, contre rétribution) la complicité des milieux
politiques avec la bénédiction (elle aussi achetée) du milieu ecclésiastique.
La soudure entre les diverses pièces du puzzle est réalisée par les
francs-maçons de la P2, toujours sur la brèche.
En
ce qui concerne l'implication de certains écclésiastîques dans
l'affaire, nous remarquerons que la persistance , mais aussi la dégénérescence
- d'une hiérarchie Religieuse encore et toujours de type féodal que les
termes du 'nouveau' concordat confirme, offre de notables espaces de
manoeuvre à qui, religieux ou non, sait s'approprier ce système de la
soumission. La culture de la 'subordination escomptée' légitime - après
les avoir produits tous les
abus et génère, puisque ses effets s'entrecroisent, l'insolence chez les
possédants, la manigance et l'escroquerie chez les dépendants, et
l'oubli dans la masse impuissante et soumise à l'écrasante logique du
pouvoir. Et, dans cette perspective, ce n'est certes pas par hasard qu'au
coeur des régions les plus déshéritées et traditionnalistes de
l'Italie, la domination mafieuse rencontre souvent et parfois se juxtapose
à la domination des forces politiques démocrates chrétiennes, émanation
directe de la hiérarchie religieuse. Une clé de lecture qui restitue au
'Guépard', le roman de Tomasi di Lampedusa, toute sa valeur prémonitoire…
Mais
revenons-en à Umberto Ortolani. Après plusieurs opérations très
compliquées (comprenant même l'enlèvement de son fils Amedeo, pour
lequel il paya une rançon dont la réunion l'engageait "pour le
futur" vis-à-vis de ses associés), il se retrouva en 1977 à siéger
dans le conseil d'administration de la Rizzoli, la plus grosse maison d'édition
italienne dont le contrôle finira par échoir au IOR et à quelques
« sociétés-bidon » de Roberto Calvi. Dans le mouvement,
intervint aussi la banque Rothschild de Zurich. La Rizzoli est propriétaire
de l'hebdomadaire Europeo : on commence maintenant à comprendre pourquoi
son directeur fut contraint à se retirer lors de la publication de cette
enquête sur le patrimoine immobilier du Saint-Siège...
Par
la suite, Ortolani sera encore inquiété pour une histoire peu claire de
financement au parti socialiste italien (15 millions de dollars) qui
seraient sortis des caisses de la Bafisud, mais dont personne n'a jamais
pu retracer le parcours exact. Un mystère identique entoure le rôle
d'Ortolani dans la disparition du pot-de-vin officiel de l'Italie à
l'Arabie Saoudite.
De
plus en plus critiqué, l'avocat était obligé de renoncer à son
appartenance à l'ordre de Malte et de restituer le passeport diplomatique
qui lui avait été confié (l’ordre de Malte, souveraineté sans
territoire, partage avec le Vatican le privilège d'entretenir une
diplomatie). Ortolani devait faire l'objet d'un mandat d'arrêt
international en 1981. Mais, réfugié au Brésil où ses protections lui
avaient offert une nouvelle virginité, son arrestation à San Paolo en
1983 (un mois après l'évasion de Gelli) était à considérer comme
nulle et non avenue. La même année, ils disparaissait discrètement de
la liste des gentils hommes de la Sainteté, à propos de laquelle il
n'existe néanmoins aucun règlement relatif à la radiation de la justice
italienne : bien que toujours poursuivi par son mandat de capture, il
'conseillait' par voie de presse à ses juges de lui attribuer l'honneur
des arrêts au domicile, et faisait mettre sous séquestre rien moins que
quatre livres parlant de ses relations avec la P2 et le Vatican retenus
par lui diffamatoires. Ortolani, au casier judiciaire toujours vierge, est
décrit dans la sentence de séquestre comme un homme 'entouré de la plus
haute estime générale' et 'à la conduite exemplaire et sans tache'. Une
certaine odeur de revanche de la P2…
Carlo
Pesenti
Derrière
une bonne partie des entreprises financières du "trio GOC"
plane l'ombre discrète, mais persistante, d'un autre grand argentier
catholique : Carlo Pesenti
Carlo
Penseti est mort en septembre 1984, à 77 ans. Malade du coeur, une
maladie diplomatique qui l'aidait souvent à ne pas se présenter devant
la justice, il démontra jusqu'à la fin une grande vigueur dans la
gestion de son empire fait d'industries, de banques, de sociétés
d'assurances, de journaux, et de trafics variés.
Penseti
catholique très pratiquant, émergeait dans l'immédiat après-guerre à
Bergame. Avec la caution de la curie épiscopale, il reprenait la
direction de l'Italcementi, une industrie détenant alors la moitié du
marché italien des matériaux de construction, héritée d'un oncle par
trop fasciste de neveu partageait les mêmes idéaux, mais de manière
moins offensive). L'oncle Antonio, sénateur du royaume, président de la
Banco di Roma, ami intime de Mussolini, avait construit une fortune sur
les exportations coloniales en Abyssinie et sur ses fabriques en Ethiopie.
Carlo, plus tard, réussira avec l'aide d'appuis politiques bien placés à donner de lui-même et de la famille l'image
d'anti-fascistes persécutés lui permettant de participer de plein droit
au boom économique des années Cinquante et à la spéculation immobilière
orchestrée par le Vatican. Faisant valoir ses réussites, il recevait
l'aval de politiciens émergeants (dont celui de Giulio Andreotti) et
multipliait son rayon d'action : il sauvait du scandale, en les
redressant, deux banques catholiques (en remerciement, le Vatican l'aidera
à conquérir son premier institut de crédit) ; il fondait
l'Italmobiliare, une société versée dans la spéculation immobilière ;
à la fin des années Soixante-dix, il pouvait compter sur l'intervention
d'Emilio Colombo, démocrate-chrétien et ministre du Trésor, pour empêcher
Sindona de mettre la main sur l'Italcementi Et il renforçait aussi ses
liens avec les milieux ecclésiastiques et rencontrait monseigneur
Marcinkus.
Son
système, pour multiplier l'argent, était à l'épreuve du feu profitant
du mouvement de la reconstruction, il avait fait inscrire le ciment dans
la liste des produits à prix contrôlé (liste dressée par le ministère
de l'Industrie, aux mains des démocrates-chrétiens). Le mécanisme est
simple : le prix du ciment était établi sur base du coût de production
de cimenteries peu rentables (et maintenues artificiellement en activité),
ce qui permettait de gonfler les gains des autres entreprises, rentables
celles-là. En plus, Pesenti recourait massivement à des emprunts à bas
intérêt, spéculant sur l'érosion monétaire.
A
la différence de Sindona, le financier d'assaut, Pensenti assurera vite
au Vatican une collaboration économique plus lente et camouflée , mais
aussi plus solide et durable. Définitivement entré dans les secrets des
princes de l'Eglise (Jean XXIII l'appelait respectueusement 'Monsieur
Karoli') il suivra de loin les périlleuses évolutions de Roberto
Calvi.Giulio Andreotti a été appelé par le Parlement italien à répondre,
à la fin de l'année 1984, de ses responsabilités en tant que ministre
vis à vis de la loge maçonnique P2 de Sindona, et du trafic des pétroles.
Chaque fois, il a su trouver les justes arguments et les justes alliances
pour être blanchi de tout soupçon. Et déplacer le débat du thème de
la culpabilité à celui de la bonne foi du politicien harassé par la
t^pache.
Giulio
Andreotti est l'homme du compromis, du statu quo entre les parties. Son
pouvoir naît de la capacité de savoir combiner l'équilibre des forces
pour déterminer un effet favorable à la Démocratie chrétienne, sans
jamais oublier les intérêts du Vatican. Cette politique mire, avant
tout, à ne produire aucun résultat, mais plutôt à renforcer la capacité
d'agrégation de ses représentants.
Andreotti
est dépourvu de projet au-delà de la reconduction du pouvoir cristallisé
autour de sa personne. Il intronise sujet politique tout qui (comme
Sindona) a acquis une parcelle de pouvoir objectif disponible à
s'associer à la sienne. Au point de prétendre 'Le pouvoir use. Celui qui
ne l'a pas.' Et il a cyniquement raison en Italie, qui a le pouvoir ne
l'exerce pas et donc, selon l'inverse de la loi de la démocratie, ne
s'use pas. Au contraire, l'opposition est sempiternellement obligée à
prendre position, donc à brûler ses ressources. Andreotti peut être défini
comme un pur produit de la politique, version Saint-Siège : son but est
de maintenir ce qui existe et esquivant toute possibilité de changement.
Il
est d'ailleurs et depuis toujours en étroite relation avec la hiérarchie
religieuse qu'il n'hésite jamais à défendre : lors d'une conférence de
presse où il était question des opérations financières secrètes de la
'maison de Saint-Pierre', il se demandait :'Comment faire autrement, tout
en conservant la même productivité ? Alors que la très grande majorité
des fidèles est désormais dans le Tiers-Monde, et que le Saint-Siège se
trouve dans la position, non plus d'être financé par eux, mais de les
financer ? 'Andreotti peut avoir raison. Pourtant, si le problème existe,
il n'est pas de savoir si le Vatican agit ou non comme n'importe quelle
entreprise en quête de profits mais bien que, malgré les nombreuses révélations
et mises en accusation, il continue obstinément de prétendre ne pas le
faire. L'explication de cette attitude est que la plupart des accusations
ne bénéficient pas d'une publicité hors des frontières de l'Italie
et ainsi la réputation du Saint-Siège et du pape en demeure
intouchée dans, justement, les pays les moins informés, c'est à dire
ceux du Tiers-Monde. Dans ces contrées, est avant tout projetée d'image
d'Epinal d'un pape polyglotte, doté d'une résistance physique à la
limite de l'humain, et grand dispensateur de discours d'apaisement. Tout
l'appareil administratif et économique qui produit, diffuse et entretient
ce cliché est soigneusement gommé comme
le sont les appuis politiques, tel celui d'Andreotti, dont le Saint-Siège
ne pourrait à plus d'un titre se passer. Et Andreotti d'insister, à
propos des méfaits de Calvi, Sindona et Ortolani
'Les cardinaux, disait-il, ne sont pas extralucides : ils ne
peuvent prévoir si tel ou tel financier se révélera être un escroc.'
Chiffres en main, la malhonnêteté des autres est un risque qu'ils sont
en effet en mesure de se permettre...
Giulio
Andreotti est encore, dit-on, un fervent souteneur des réunions de la
droite européenne tenues par Antoine Pinay.
Antoine
Pinay, ancien président du conseil des ministres de la quatrième République
française, entraîne aussi dans ces réunions le comte Alain de Villegas
et maître Jean Violet, titulaire de la Légion d'Honneur et fait
commandeur de l'ordre de Saint George par Paul VI. Jean Violet est en
relation politique et financière avec l'Union Paneuropéenne, organisme
d'extrême droite fondé par Otto de Habsbourg, dont une des antennes est,
en Belgique, l'Académie Européenne des Sciences Politiques (AESP) où sévit,
à nouveau, Alain de Villegas.
Soutenu
par maître Violet, Villegas fait accepter par Alfredo Sanchez Bella, un
pur du franquisme, alors ministre en Espagne et membre de l'Opus Dei, deux
projets de recherche d'eau potable qui, après expérimentation en 1970,
se résumeront en un fiasco. Carlo Pensenti ami de Sanchez Bella, et
Philippe de Weck, président de l'Union des Banques Suisses, participent
aux frais.
Le
terrain est prêt pour une escroquerie de plus grande envergure cette
fois-ci aux dépends de l'Etat français, et connue sous le nom d'
'affaire des avions renifleurs' : près de 100 millions de FF pompés,
entre 1975 et 1979, par Villegas et Aldo Bonassoli autre 'inventeur'
italien. Leur contrat reçoit le parrainage de Sanchez Bella, décidément
peu découragé, de Philippe de Weck, de Carlo
Pesenti
de 'personnes ecclésiastiques' comme le dit le rapport de la Cour des
comptes française, et aussi de Daniel Boyer (qui contrôle la Prelate
Corporation, détentrice des droits exclusifs de reproduction de la
bibliothèque apostolique du Vatican - Boyer est d'autre part propriétaire
du mensuel belge l'Evènement) et de Crosby Kelly, ex-technicien en
armements, déjà en poste à Cuba, organisateur des cérémonies du
bicentenaire des USA en Belgique et sans doute 'propagandiste' de la CIA
Entre Jean Violet et Philippe de Weck, agit comme intermédiaire le père
Dubois, un dominicain mort en 1979 qui avait intercédé auprès de Paul
VI pour faire attribuer la croix de l'ordre de Saint George à Violet. Et
puis Philippe de Weck, dont la banque UBS a pour conseiller un certain
Sanchez Bella, a auparavant été en affaires avec Sindona et Pesenti et
est membre d'une commission d'experts désignée par le pape pour réformer
le règlement du IOR.Enfin, pour les transferts de fonds, intervient
l'Ultrafin une société financière du groupe Calvi, et la Banco
Occidental de Madrid, proche du IOR et de l'Opus Dei.
Non
pas que nous voudrions dire que le Vatican se trouve intéressé dans
toutes les opérations financières à odeur d'escroquerie, mais il faut
reconnaître que les mondes ecclésiastique politique et financier
qui relèvent d'une même classe dirigeante
en conjuguant heureusement leurs privilèges parviennent à réaliser
des profits contribuant, en définitive, à la reproduction de cette même
classe. Ou, comme le disait Sanchez Bella : 'Le monde se fait grâce à
ces trois ou quatre mille individus qui forment l'élite intellectuelle
internationale, mais qui ne parlent pas toujours de politique. De
Politique avec la majuscule, oui, mais pas de politique partisane.' Et il
ajoutait, à propos des avions renifleurs : 'L'essentiel était que (cette
invention) ne tombe pas aux mains des Soviétiques.' Où l'avidité du
gain rejoint l'idéologie pathologique.
Finances
'blanches'
Entretemps
l'idée de la 'super-banque catholique' a continué à animer les esprits
en Italie. La tendance qui prévaut aujourd'hui est à la concentration
des instituts financiers et au jeu à la hausse en bourse sur promesse d'élargissement
et de restructuration : autant de mouvements coordonnés par des hommes de
confiance du Vatican comme Carlo Pesenti ou le cardinal Siri, l'archevêque
de Gênes qui a su se rendre tellement indispensable qu'à 79 ans, il n'a
pas encore à ce jour été mis à la retraite (il est d'autre part l'un
des promoteurs avec le cardinal Ratzinger du retour du latin dans la
messe). Prêtant son concours à divers groupes de pression (en
particulier, la bourgeoisie des entrepreneurs) il a développé dans les
institutions économiques et politiques de sa ville un pouvoir de fait et
une clientèle solide. A tel point que sa cure est devenue une sorte
d'office de placement auquel n'échappe aucune nomination et aucune
attribution de subvention officielle, et est bien fréquentée par cette
élite financière unie par de profonds liens qui, au-delà du goût pour
l'argent, se sent investie d'une mission (produire de la richesse pour la
plus grande gloire du Saint-Siège) et pratique la loi du silence.
Mais
reste que les dettes contractées directement ou indirectement par le IOR
demeurent en bonne partie impayées. Calvi s'était engagé à assumer la
faillite de Sindona, mais en est mort. Et monseigneur Marcinkus, que
fait-il ?
Paul
Marcinkus après de longues tergiversations, acceptait 'en reconnaissance
de son implication morale' (la sienne et celle du IOR de s'associer pour
un montant de 250 millions de dollars à la réparation offerte par le
Banco Ambrosiano, la banque de Calvi, à ses principaux créditeurs.
Etrange comportement du IOR qui s'est toujours déclaré étranger aux
accusations de complicité qui lui étaient lancées
mais comportement prévoyant, si l'on considère qu'il permet d'éviter
un procès international où De Strobel Marcinkus et Mennini auraient bien
plus difficile qu'en Italie de se prévaloir de l'immunité diplomatique ;
alors qu'il s'agissait aussi de présenter le bon profil à la veille de
la signature du 'nouveau' concordat et de restaurer la crédibilité du
IOR en tant que banque d'envergure mondiale.
Afin
de réunir les fonds nécessaires à la réalisation de ses engagements
définis comme 'une contribution volontaire'
le IOR s'apprête à liquider certaines de ses participations en
France et aux Etats- Unis, en plus de vendre à la Sumitomo Bank japonaise
la Banca del Gottardo et de se débarrasser d'une société immobilière
romaine. Le tout, y compris le paiement direct déjà invoqué, se montant
à quelque 400 millions de dollars, soit les deux tiers de ce que réclamaient
les 120 créditeurs étrangers des Italiens restant sur leur faim). Quant
aux frais de justice (15 millions de dollars), personne ne sait encore qui
les supportera. Marcinkus n'en a pas pour autant perdu la raison
l'accord final prévoit aussi le recouvrement d'un tiers des crédits
contractés en Amérique du Sud par deux banques étroitement liées au
Vatican.
L'accord,
étant donné qu'il est 'régi par la loi italienne', pourrait aussi
sonner le glas des privilèges du Vatican en matière financière, l'empêchant
de jouer sur le conflit de compétence entre droit italien et droit canon.
Techniquement, la création d'une filiale italienne du IOR résoudrait le
problème en soumettant le IOR à la loi italienne. Reste à savoir quand
cette filiale sera effectivement créée. Tandis que les poursuites intentées
à Pellegrino De Strobel Luigi Mennini et Paul Marcinkus restent elles
aussi au conditionnel. Tout au plus le 'nouveau' concordat signale-t-il
que 'le SaintSiège confirme sa disponibilité à examiner avec le
gouvernement italien les questions regardant les activités en Italie de
l'Institut pour les OEuvres de Religion', sans échéance.
La
société romaine dont s'est débarrassé le Vatican se nomme Vianini et
est la quatrième entreprise italienne en matière de grands chantiers de
constructions. Dans son conseil d'administration, siègent de Strobel et
Mennini. Elle a été acquise par Franco Caltagirone membre d'une famille
active depuis plus d'un demi-siècle dans le bâtiment, fort liée à
Andreotti, et rendue célèbre en 1981 par une banqueroute frauduleuse qui
poussa deux des cousins de Franco à l'exil. Leur mandat d'arrêt devait
être révoqué en janvier 1984, à peine une semaine avant la signature
du contrat Vianini, lequel représente pour les Caltagirone, après tant
de tribulations, un retour en grand style sur la place des affaires
romaines. Poursuivis pour fraude fiscale et exportation illégale de
capitaux (réalisée à travers le IOR et la Finabank de Sindona, pour un
montant évalué en 1974 à 3 millions de dollars), les deux cousins
avaient déjà bénéficié d'une prescription et, qui plus est, de
l'inscription au passif de leur société en faillite de l'amende de 8
milliards de Lires avec frais de justice à charge de l'Etat. Le juge
chargé de l'affaire était Antonio Alibradi, déjà rencontré lors des
tribulations de Michele Sindona.
Le
Vatican, entre tous ses autres trafics, s'intéresse encore en Italie aux
'patronages', ces organismes d'assistance technico-légale et médicale en
faveur des travailleurs, liés au syndicats, aux partis politiques, et à
l'Eglise. Ils traitent en moyenne 15.000 dossiers par an, pour lesquels
ils reçoivent une subvention officielle de 150 milliards de Lires. Un
projet de loi déposé par un parlementaire démocrate-chrétien élu avec
l'appui de Communion et Libération voudrait en faire des coopératives
privées, donc payantes ce
qui, au prix courant des démarches légales, leur rapporterait 750
milliards de Lires en plus de la subvention. El, actuellement, les
organisations catholiques s'emploient de manière insistante à multiplier
le nombre de 'patronages' à leur dépendance.
En
conclusion ? Les finances du Vatican sont telles : elles font l'objet d'un
bilan officiel toujours mélancolique et ne représentant qu'une minime
partie la seule avouable
des affaires brassées. Tandis que les autres opérations, souvent
difficiles à individualiser, influencent de manière insidieuse l'entièrté
des activités économiques et politiques italiennes.
Et
il y a cette légende : en l'an 258, le diacre Laurent fut brûlé vif par
l'autorité impériale pour avoir refusé de livrer les richesses accumulées
par ce qui était alors la communauté chrétienne de Rome et ne
deviendrait qu'un demi-siècle plus tard l'Eglise. Le diacre Laurent s'était
montré prudent : il avait fait distribuer les biens aux pauvres de la
ville et, du haut de son bûcher, les indiqua comme le vrai et unique trésor
de la communauté. La légende n'explique pas comment l'Eglise parvint,
ensuite, à reconstituer son trésor. De cette action-là, continue et
opiniâtre, nous venons d'avoir quelqu'aperçu.
Frédéric
Hacourt, Mai 1984
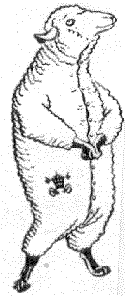
Appendice
1
Criminalité internationale
La Banque du Vatican au hit-parade des
dix destinations les plus utilisées pour le blanchiment d'argent.
Selon une source internationale,
le Vatican est le principal destinataire de plus de 55 milliards
de dollars US d'argent sale italien et se place à la huitième
place des destinations utilisées à travers le monde pour le
blanchiment d'argent, devant des paradis fiscaux comme les
Bahamas, la Suisse ou le Liechtenstein.
Une enquête récente du
"London Telegraph" et du "Inside Fraud
Bulletin", cite la Cité du Vatican [1]
comme étant un des principaux États "cut out" au même
titre que des paradis fiscaux tels que Nauru, Macao et l'Ile
Maurice. Un État "cut out" est un État dans lequel la
législation sur le secret bancaire rend impossible la traçabilité
de l'origine des fonds qui y sont déposés.
La Banque du Vatican tente désespérément
de s'opposer à une plainte en justice déposée par des
survivants serbes et juifs de la Shoah devant la cour fédérale
de San Francisco (Affaire "Alperin contre la Banque du
Vatican") et visant à l'obliger à rendre compte de fonds
spoliés lors de la Deuxième Guerre Mondiale [2].
S'opposant à ces accusations, l'avocat de la Banque du Vatican,
Franzo Grande Stevens a déclaré sous serment devant la cour, que
la "raison d'être fondamentale [de la Banque du Vatican] est
de promouvoir des actes de piété" et que ses clients dépositaires
sont "essentiellement des employés de l'État de la Cité du
Vatican, des membres du Saint Siège, des congrégations
religieuses ainsi que des personnes déposant des sommes destinées
pour une part au moins à des œuvres de piété." Stevens a
également déclaré à la cour que la Banque du Vatican est sous
le contrôle du Pape et que les registres de la banque ne sont pas
conservés au-delà d'une période de dix ans.
Il semblerait que la Banque du
Vatican utilise l'image positive du Pape Jean Paul II pour masquer
une opération de blanchiment d'argent de grande envergure. La
Banque du Vatican a déjà été accusée par le passé d'héberger
des fonds spoliés par les Nazis et est actuellement soupçonnée
d'entretenir des liens avec le milieu du crime organisé, en conséquence
le moment où elle devra rendre des comptes semble ne plus être
bien loin. Les preuves s'empilent et tendent à démontrer que les
activités de la banque s'apparentaient plus à des actes de
piraterie que des œuvres de piété [3].
Me Jonathan Levy
et Me Thomas Dewey Easton,
avocats à la cour fédérale de San Francisco
[1]
À la différence des autres paradis fiscaux, le blanchiment
d'argent n'est pas opéré dans l'État de la Cité du Vatican par
des banques privées, mais par la Banque centrale (Istituto per le
opere di religione). Celle-ci est reconnue par la Banque des règlements
internationaux (Bank for International Settlements). À partir du
1er janvier 2002, elle sera autorisée à émettre des euros
vaticans, alors même que l'État de la Cité du Vatican n'est pas
membre de l'Union europénne (Ndlr).
[2]
Cf. http://www.vaticanbankclaims.com
[3]
Dans les années quatre-vingt, le Saint-Siège, qui avait été
gravement mis en cause dans le scandale du Banco Ambrosiano, prétendit
avoir été victime d'un aigrefin, Michele Sindona, que le pape
Paul VI avait imprudemment nommé conseiller financier du Vatican.
L'enquête du juge Ferdinando Imposimato a démontré par la suite
que Michele Sindona avait été choisi en connaissance de cause
par le Saint-Siège parce qu'il était, depuis 1957, le banquier
de Cosa Nostra. Pour financer la lutte contre la théologie de la
libération en Amérique latine, Paul VI avait accepté de faire
alliance avec la mafia. Après le règlement des dettes de
l'Ambrosiano, le Saint-Siège s'est efforcé de faire accroire
qu'il avait définitivement assaini sa situation. L'étude publiée
par l'Inside Fraud Bulletin montre qu'il n'en est rien (Ndlr).
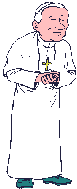
Appendice
2
A41
- Texte intégral de l'Accord conclu entre le Vatican et l'Autorité Palestinienne.
Article
de Parole de Vie - Reproduction autorisée, pourvu qu'elle
soit intégrale, et que la source soit indiquée.
Nous
avons pu nous procurer le texte intégral de l'accord conclu entre le Pape
Jean-Paul II et Yasser Arafat. Voici sa traduction en français, assortie
de commentaires personnels.
Nous
avons également traduit le récit d'un rabbin israélien invité récemment
au Vatican, pour une conférence inter-religieuse.
Le
rapprochement de ces deux documents est très intéressant, dans la
perspective de la fausse paix qui doit être conclue entre Israël et
l'Antichrist, d'après la Bible, et qui marquera le début de la Grande
Tribulation.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traduction
du texte intégral de l'accord entre le Vatican et l'OLP :
Mardi
15 février 2000
Préambule :
Le
Saint-Siège, Autorité Souveraine de l'Eglise Catholique,
et l'Organisation
de Libération de la Palestine (ci-après dénommée OLP), agissant en
tant que représentant du Peuple Palestinien, travaillant au profit et en
tant que représentant de l'Autorité Palestinienne.
Profondément
conscients de la signification particulière de la Terre Sainte, qui
constitue, entre autres, un espace privilégié pour le dialogue
inter-religieux entre les adeptes des trois religions monothéistes.
Ayant
considéré l'histoire et le développement des relations entre le
Saint-Siège et le Peuple Palestinien, en particulier les relations de
travail et l'établissement subséquent, le 26 octobre 1994, de relations
officielles entre le Saint-Siège et l'OLP.
Rappelant
et confirmant la création de la Commission de Travail Bilatérale
Permanente, ayant pour tâche l'identification, l'étude et le suivi des
problèmes d'intérêt commun entre les deux parties. Réaffirmant
le besoin de conclure une paix juste et complète au Moyen-Orient, afin
que toutes les nations de cette région puissent vivre en bon voisinage et
travailler en commun au développement et à la prospérité de toute la région
et de tous ses habitants. Appelant
à une solution pacifique du conflit Israélo-Palestinien, qui tiendrait
compte des aspirations et droits nationaux légitimes et inaliénables du
Peuple Palestinien, par la négociation et la conclusion d'un accord
capable d'assurer la paix et la sûreté à tous les peuples de la région,
sur la base de la justice et de l'équité, ainsi que du droit
international, en particulier des résolutions du Conseil de Sécurité
des Nations Unies touchant à ce problème. Déclarant
qu'une solution équitable du problème de Jérusalem, fondée sur les résolutions
internationales, est fondamentale pour une paix juste et durable au
Moyen-Orient, et que toutes les décisions et actions unilatérales
modifiant le caractère et le statut spécifiques de Jérusalem sont
moralement et légalement inacceptables.
Appelant
par conséquent à adopter un statut spécial pour Jérusalem, statut
faisant l'objet de garanties internationales, et qui devrait sauvegarder
ce qui suit :
-
La liberté de religion et de conscience pour tous.
- L'égalité
devant la loi des trois religions monothéistes, de leurs institutions
et de leurs fidèles, à l'intérieur de la Cité.
-
L'identité
propre et le caractère sacré de la Cité et de son héritage
religieux et culturel significatif.
-
Les
Lieux Saints, leur liberté d'accès et la liberté de culte à l'intérieur
de ces Lieux.
-
Le
régime du statu quo dans les Lieux Saints, là où il s'applique.
Reconnaissant
que les Palestiniens, quelle que soit leur affiliation religieuse, sont
des membres à part entière de la société palestinienne.
Concluant
que les travaux de la Commission de Travail Bilatérale Permanente
mentionnée supra sont suffisamment avancés pour permettre la signature
d'un premier accord fondamental, qui doit offrir un fondement solide et
durable au développement continu de leurs relations présentes et
futures, et pour la poursuite des travaux actuels de la Commission.
Se
sont accordés sur les Articles suivants :
Article
1
Paragraphe
1 :
L'OLP
affirme son engagement permanent à soutenir et à observer le droit
humain à la liberté de religion et de conscience, tel qu'il est défini
dans la Déclaration des Droits de l'Homme et dans d'autres textes
internationaux relatifs à son application.
Paragraphe
2 :
Le
Saint-Siège affirme l'engagement de l'Eglise Catholique à soutenir ce
droit et réaffirme une fois encore le respect accordé par l'Eglise
Catholique aux fidèles de toutes les autres religions.
Article
2
Paragraphe
1 :
Les
Parties s'engagent à coopérer de manière appropriée pour promouvoir le
respect des droits de l'homme, individuels et collectifs, pour combattre
toutes les formes de discrimination et de menaces contre la vie et la
dignité de l'homme, et pour promouvoir la compréhension et l'harmonie
entre les nations et les communautés.
Paragraphe
2 :
Les
Parties continueront à encourager le dialogue inter-religieux, pour la
promotion d'une meilleure compréhension entre les peuples de différentes
religions.
Article
3
L'OLP
assurera et protègera dans la Loi Palestinienne l'égalité des droits de
l'homme et du citoyen pour tous les citoyens, en garantissant de manière
spécifique, et sans préjudice des autres droits, la suppression de toute
discrimination, individuelle ou collective, fondée sur l'appartenance à
une religion, à une croyance ou à une pratique religieuse.
Article
4
Le
régime du statu quo sera maintenu et observé pour tous les Lieux Saints
Chrétiens, là où il s'applique.
Article
5
L'OLP
reconnaît à l'Eglise Catholique la liberté d'exercer ses droits, de
remplir ses fonctions et de respecter ses traditions, par les moyens
qu'elle juge nécessaires, en particulier dans les domaines spirituel,
religieux, moral, charitable, éducationnel et culturel.
Article
6
L'OLP
reconnaît les droits de l'Eglise Catholique en matière économique, légale
et fiscale. Ces droits seront exercés en harmonie avec les droits des
autorités Palestiniennes dans ces domaines.
Article
7
La
Loi Palestinienne reconnaîtra de plein droit la personnalité légale de
l'Eglise Catholique, ainsi que celle de ses représentants canoniques légaux.
Article
8
Les
dispositions de cet Accord ne doivent porter préjudice à aucun autre
Accord actuellement en vigueur entre chacune des Parties et tout autre
partie.
Article
9
La
Commission de Travail Bilatérale Permanente, en accord avec les
instructions données par les Autorités respectives des deux parties,
pourra proposer d'autres moyens de développer l'étude des points du présent
accord.
Article
10
Si
une controverse se présentait concernant l'interprétation ou
l'application des dispositions du présent Accord, les parties la règleront
par le moyen d'une consultation mutuelle.
Article
11
Fait
en deux exemplaires originaux, en langue arabe et en langue anglaise, les
deux textes étant déclarés également authentiques. En cas de
divergence, seul le texte anglais fera foi.
Article
12
Le
présent Accord entrera en application dès le moment où il sera signé
par les deux Parties.
Signé
au Vatican, le 15 février 2000

|